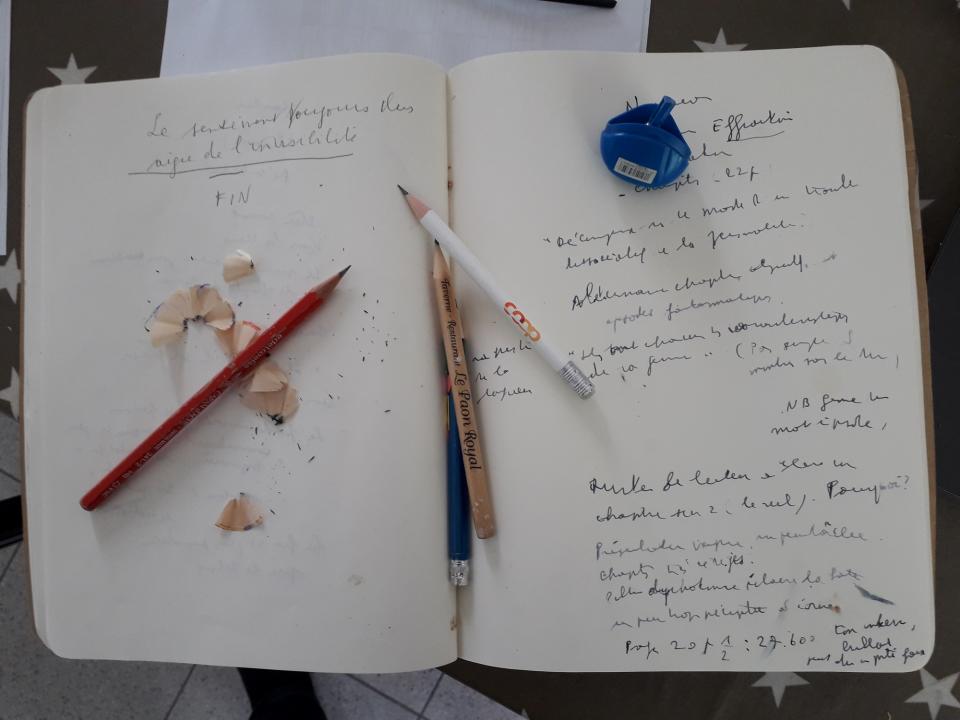Cette vie d'écrivain 1: Le malentendu
Cette vie d’écrivain #1
Le malentendu
On se met à écrire à 15 ou à 20 ans. En cachette, pour échapper aux moqueries. Personne ne croit plus à ces vieilles légendes. Un jour, quand même, on finit par publier. On donne quelques interviews, on reçoit une petite avance. Rien de sérieux, à première vue. Mais en profondeur, on est pris dans une spirale dont le mécanisme a quelque chose d’implacable.
On croyait qu’être écrivain serait une activité comme une autre, parmi les diverses entreprises possibles : une sorte de start-up avec une très faible mise de fond, peu ou pas de personnel, et une perspective de croissance raisonnable. On est embarqué dans une drôle d’histoire, dont on risque de ne plus jamais sortir (ou alors, dans quel état).
La première chose qu’on constate, c’est qu’écrivain ce n’est pas un métier. Bien sûr, la société-providence a tout quadrillé pour que cela paraisse en être un. Mais ce n’est pas un métier. Il n’y a pas de patron, pas de collègues, pas de bureau paysagé, pas même de marchandise. C’est déjà un signe. Dans le monde du travail, fait pour le salariat, une profession qui n’est ni technique, ni commerciale, ni juridique, ni médicale, ni pédagogique, ni virtuelle, et dont la finalité n’est même pas de produire et de vendre des livres, mais de favoriser les herbes folles de l’esprit, on ne sait pas du tout ce que c’est. Même les mannequins, les naturopathes, les consultants en stratégie, les gourous, les conseillers bancaires, ont une réalité profonde, parce qu’on sait, ou du moins on croit savoir, à quoi ils servent et ce qu’ils vendent. On peut avoir des réserves sur l’intérêt et l’avenir de leur profession, mais ils peuvent expliquer en moins d’une minute pourquoi leur activité répond à une demande essentielle.
La demande à l’égard des écrivains n’est pas claire du tout.
Si on interroge un échantillon de lecteurs, ou même certains auteurs pris par surprise, là où ils ne sont pas au meilleur d’eux-mêmes, par exemple dans des salons du livre, ils diront sans doute que l’activité des écrivains consiste à raconter des histoires pour divertir autrui, en échange d’une certaine rémunération. Mais même dans le cas des romanciers (ne parlons pas des essayistes et des poètes), ce n’est pas vraiment de cela qu’il s’agit. Entre l’intrigue véhiculée par le livre et le public, il y a un écran de cristal plus ou moins déformant : la littérature.
Tout le jeu consiste à donner aux mots et aux phrases un sens légèrement décalé, par rapport à leur usage, sans pour autant perdre le fil du sens. Cela en vue de produire des sensations, des émotions, des vues, des arrière-pensées, en général mis en veilleuse dans le cours ordinaire de sa vie. En sorte que l’écriture, à ses meilleurs moments, dans ses plus hauts points de fusion, remue et bouleverse les plaques tectoniques du monde visible dans l’esprit du lecteur. Il entrevoit ainsi une vie plus rapide, plus tragique ou plus belle qu’elle n’est sans doute (ou seulement en secret).
La littérature n’est pas l’art de raconter des histoires, mais une façon de densifier la vie. Elle transforme la banalité ou le hasard en nécessité et en destin. De là découle la situation paradoxale de l’écrivain (quand il est un peu enragé) : il n’est pas un professionnel de l’écriture, utilisable à des fins définies, mais un éternel outsider, qui se débrouille comme il peut dans un monde parfaitement organisé pour se passer de lui.