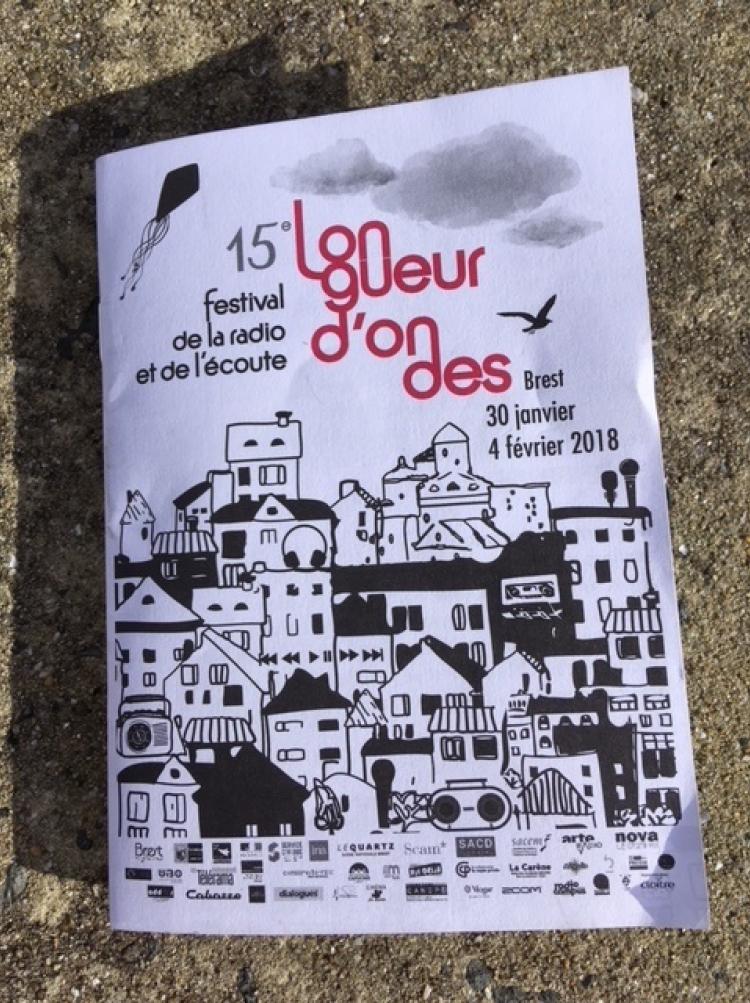Cette vie d'écrivain 4: Le chagrin familial
Cette vie d’écrivain #4
Le chagrin familial
La vocation d’écrire, si ça existe, ne se déclare pas. Ce serait d’ailleurs bien inutile. Vos parents ne sont pas tout à fait abrutis. Ils ont eu l’occasion de constater que depuis plusieurs années, vous passiez plus de temps à tricoter des histoires sur votre clavier et à lire des auteurs non prévus au programme qu’à combler vos lacunes en géographie ou à gérer vos liens sociaux. Du reste il ne sert à rien de faire des effets d’annonce puisqu’il n’y a pas d’école d’art d’écrire dont le diplôme serait nécessaire à vos projets. Si on vous laissait faire au lieu de vous demander tous les deux mois quel métier vous tente, vous n’entreprendriez aucune étude, ou plutôt vous poursuivriez celles que vous avez entamées depuis que vous savez remplir un cahier, et qui vous occuperont bien pour les quatre-vingts ans à venir. Le reste n’est qu’un affreux malentendu.
Le paradoxe du Sergent Major (appelons-le comme ça), qui fait que l’acte d’écrire implique le même dispositif apparent, qu’il s’agisse de griffonner une carte de vœux de Noël ou de rédiger l’Éducation sentimentale, empêche la plupart des gens de comprendre que la littérature est une activité à temps plein.
Presque personne ne croit qu’on puisse être peintre accompli ou comédien au sommet de son art tout en exerçant à d’autres moments de la journée le métier de plombier ou de chirurgien. Personne ne s’étonne que de brillants lycéens se dirigent vers le conservatoire d’Art dramatique ou l’École des Beaux-arts. Mais le choix d’une carrière d’autodidacte où tout ce qui compte s’obtient avec des procédés d’alchimiste comme le travail, la concentration, la lecture de vieux livres et une bonne part de hasard, demeure largement incompréhensible. Depuis que le monde est monde, tous ceux qui voient un de leurs enfants s’enfermer dans cette obsession de l’écriture ont le cœur serré.
Je repense à mes propres parents. C’est peu de dire qu’ils n’étaient pas ravis de la tournure que prenait ma vie. Ils avaient cru que je leur ferais honneur dans la diplomatie ou dans l’enseignement (c’était presque la même chose à leurs yeux). Ils savaient bien que j’avais un petit tropisme littéraire. Ils espéraient que cela me passerait. Ils espéraient surtout que je ne trouverais pas d’éditeur pour publier mes extravagances. Et si malgré tout un livre paraissait, ils comptaient sur un reste de décence de ma part pour prendre un pseudonyme absolument opaque.
Rien de tout cela ne s’est produit. Les bêtises ont été écrites. Les livres ont paru. Une poignée de mauvais sujets les ont lus. Mon nom, leur nom, figurait sur la couverture, comme un agrandissement de la signature d’un pacte avec le diable.
Je leur rendais parfois visite, malgré la distance et les malentendus. On ne parlait pas de tout cela, on ne parlait pas de grand-chose, mais je savais ce qu’ils avaient en tête. Ils regardaient mes vêtements pour savoir si je les avais achetés aux puces (en fait, oui). Ils scrutaient mon visage pour mesurer les progrès du vice et du malheur. Pour eux une vie d’écrivain était un mélange de dénuement, de libertinage et d’impiété (en somme ce n’est pas faux). J’essayais de les rassurer. Je leur apportais des cadeaux qui augmentaient encore, si possible, leur méfiance. Ils demandaient si cela ne me coûtait pas trop cher, tous ces livres que je publiais.
Ils étaient abonnés à la bibliothèque municipale dont la responsable, croyant leur faire plaisir, mettait en évidence mon petit dernier. Cela les rendait fous de contrariété. Il leur arrivait d’emprunter cet exemplaire unique et de le garder de longs mois malgré les rappels, pour le soustraire à la vue des autres lecteurs.
Quand même ils m’aimaient bien, j’étais leur fils prodigue. La dernière fois que j’ai vu mon père, avant qu’il n’entre à l’hôpital, il m’a offert un stylo Mont-Blanc.