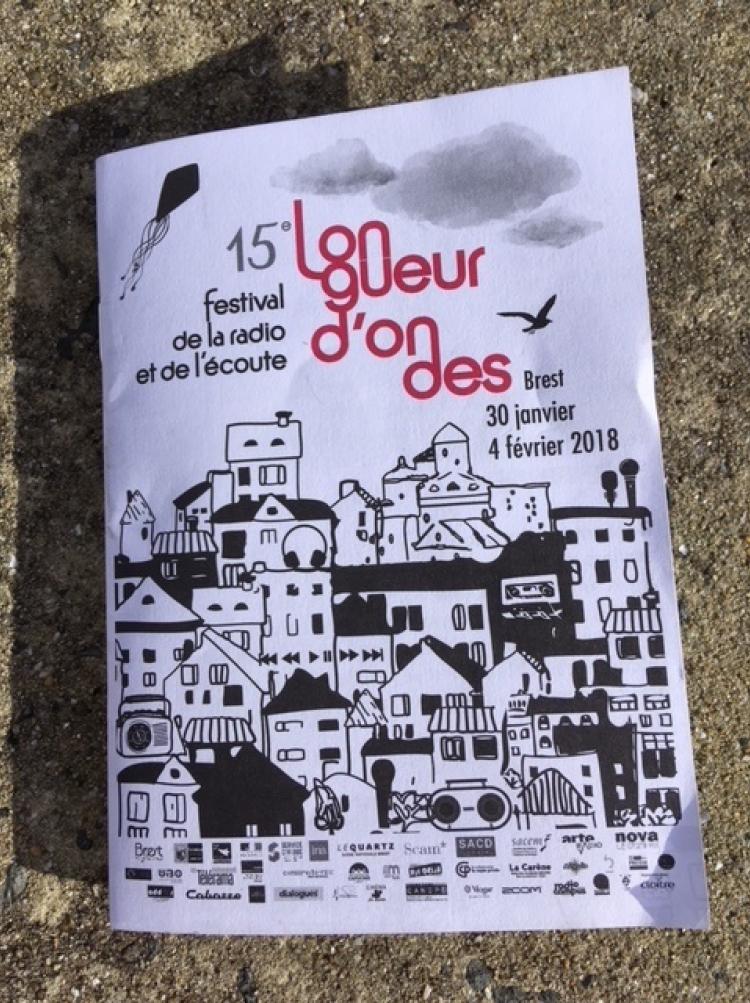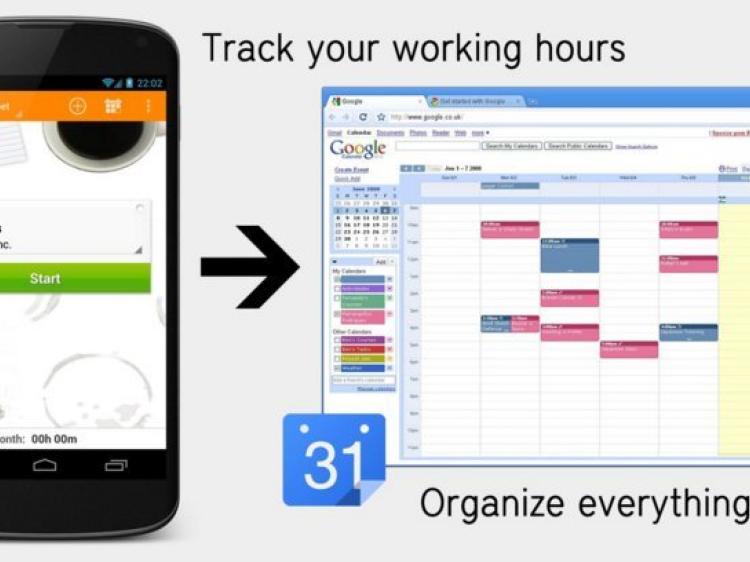Us et abus au Joyeux Pays de la traduction littéraire !
Ainsi donc les hasards de la vie m'avaient conduite, depuis un studio niçois jusqu'aux rives de l'Amstel, à traduire de l'anglais pour Rivages, ce grâce à une virée en stop entre Montpellier et Pézenas (voir épisode précédent) mais ce serait trop long à raconter.
Mon bonheur fut de courte durée : il débuta le jour de la réception de ma première traduction, qui me mit dans un tel état de transes que je m'endormis avec ! Et il se termina par un article au vitriol de Rinaldi pour ma traduction suivante.
Bon, d'accord, erreur de débutante, j'avais traduit « the back of the head » (la nuque) par « l'arrière de la tête »… D'accord, j'en rougis, ou en ris, encore, mais de là à consacrer à ce malheureux faux pas tout un paragraphe ! D'autant qu'il n'y avait pas d'autre erreur dans les 250 pages suivantes, et que la correctrice qui avait eu le texte en main après moi n'avait pas tiqué sur ma bévue alors qu'elle n'était pas contaminée par l'anglais, elle. Que ces mêmes pages aient été truffées de citations cachées de Shakespeare que j'avais su repérer et traduire ne présentait par contre pas le moindre intérêt linguistique ou littéraire au yeux de sieur Rinaldi évidemment (qui ne les avait d'ailleurs peut-être pas remarquées), trop heureux d'avoir repéré « la » faute rédhibitoire, et donc d'avoir fait son travail critique...
Ainsi j'eus droit également, dans Le Matricule des anges cette fois, à un article sur le bien fondé de l'expression « avoir un petit vélo dans la tête », ce qui, sans l'anglais pour comparer - qui se trouvait être « to have a spider in the attic » et donc tout à fait en adéquation - était une interrogation des plus oiseuses à laquelle, de nouveau, un paragraphe était consacré ! Dégoûtée par un tel coupage de cheveux en quatre pour trois fois rien, je me suis prestement désabonnée, toujours ça d'économisé (car ça gagne très peu, un traducteur littéraire).
Quelques traductions plus loin, un article élogieux dans Lire et un autre dans Le Monde des livres - de Pierre Lepape, à l'époque où il y régnait - devaient me consoler de ces deux infortunés hoquets. Quelques bourses du CNL et du CITL aussi.
La plus efficace des consolations émana néanmoins d'un délicieux auteur irlandais, celui aux citations shakespeariennes cachées, que Rinaldi n'avait pas contaminé et qui trouvait que, grâce à moi, ses romans sonnaient mieux en français qu'en anglais ! Pour me le prouver il m'offrit deux serre-livres (en tourbe séchée, if you please), ainsi qu'une bouteille de whiskey dont je garde un tout aussi délicieux souvenir…
Les années, durant lesquelles les éditeurs venaient me chercher jusqu'aux Pays-Bas, où j'habitais alors, se déroulèrent sereinement au rythme d'un ou deux livres à traduire par an, y compris ceux d'une sombre collection pour midinettes intitulée Merci, Docteur que je traduisais du néerlandais, le tout entrelardé de sous-titrages pour la Warner tandis que mon échantillon de traduction se voyait refusé chez Harlequin mais faut-il vraiment s'en plaindre ? Truffés d'anglicismes comme le sont leurs livres, ce n'est pas chez eux que l'on m'aurait critiquée pour avoir écrit « l'arrière de la tête » !
C'est, arrivée dans votre bonne ville de Bruxelles, que les choses se sont un tant soit peu gâtées, d'abord en travaillant pour Lefrancq, l'éditeur de Bob Morane, qui, en bon ancien facteur qu'il était, était à cheval sur les livraisons mais ignorait tout du concept de « contrat de traduction »...
Après quoi, ayant tout d'un coup un loyer à payer puisque je n'avais plus de mari pour s'en occuper, je suis descendue encore de quelques crans dans la qualité éditoriale.
Que dire de cet éditeur qui m'avait commandé une traduction grand public avec ordre de ne pas raccourcir le texte - ainsi que cela se fait couramment, paraît-il, dans ce genre de maisons - puis qui, le directeur éditorial ayant changé sans être informé de cet impératif, m'avait envoyé des épreuves truffées de coupes sauvages sans le moindre lien entre les paragraphes manquants ?! Quand j'ai appelé pour protester, la réponse fut : « Mais de quel droit nous faites-vous ces réflexions ? Vous n'êtes jamais que la traductrice ! ». Les informant que, selon l'ATLF, le traducteur n'était pas juste la sous-merde qu'ils sous-payaient royalement mais l'auteur légal du texte français, ils ont dû, sous menace de procédures juridiques de ma part, réintégrer le texte manquant ; autant dire qu'ils ne m'ont plus jamais appelée pour me confier une quelconque sous-merde à traduire. Dans ce métier, se faire respecter équivaut généralement à ne plus travailler.
Je devais en faire l'expérience supplémentaire avec cet éditeur un peu plus haut de gamme (comme quoi) où ma traduction avait été acceptée par le premier directeur éditorial ; sauf qu'une fois remplacé par le suivant - car la valse des directeurs éditoriaux est un petit amusement parisien du dernier chic - ma traduction avait subi moult critiques avec lesquelles je n'étais absolument pas d'accord. Pour finir, le nouveau directeur éditorial, dont on avait dû tout à coup mieux évaluer les incompétences, a été remplacé par un troisième et toutes les modifications suggérées ont été supprimées (non sans m'avoir d'abord été reprochées, un comble !), mon texte revenant à sa virginité initiale et qu'importe ma crise de nerfs et le temps perdu dans la foulée ! Tout cela au tarif horaire d'une femme de ménage… Pour plus de détails sur ce palpitant épisode, n'hésitez pas à consulter http://www.soonckindt.com/journal_de_bord.html où il est relaté plus en détail.
Ah oui, j'ai aussi en stock le souvenir de ce jour où un grand éditeur m'avait convoquée à Paris pour discuter de quelques points problématiques dans une très difficile traduction. J'avais pris ma journée, il nous faudrait bien ça, avait marmonné le grand éditeur ; pour finir, au bout de deux heures il avait estimé que, les erreurs étant toutes du même type, j'avais sûrement compris, ce n'était donc finalement pas la peine d'y passer la journée… Sauf qu'avec un billet de train non échangeable/non remboursable, j'étais condamnée à passer mon après-midi à Paris, ce qui était loin de m'enchanter.
Mais la providence veillait. Dans le restaurant où j'étais allée me consoler avec une amie de cet éditeur pour le moins cavalier, ne voilà-t-il pas que le patron nous a offert une bouteille de champagne ! Qu'il ait eu à mon égard des intentions moins que nobles n'était qu'un détail, après un tel déploiement de générosité qui avait forcément fini par égayer ma journée !
Je ne vous parlerai par contre pas des luttes intestines autour du choix d'un mot plutôt qu'un autre, qui m'a valu de perdre ma place chez un autre très grand éditeur puisque je refusais de me plier à son choix, forcément meilleur que le mien, ni de litiges autour de certaines épreuves où je n'appréciais pas les modifications apportées sans me consulter, une ire qui m'a valu de ne plus jamais travailler là non plus… Dans ce métier, se faire respecter équivaut généralement à ne plus travailler (bis).
D'autant que certains y mettaient une sacrément mauvaise volonté, et que chez Rivages les directeurs éditoriaux mouraient l'un après l'autre, me privant ainsi d'un précieux revenu...
Je peux vous parler par contre de ces (par ailleurs charmants) éditeurs où les livres à traduire étaient tellement mal écrits qu'il fallait traduire et réécrire à la fois, pour le même prix bien sûr ; ou de celui chez qui le livre avait été acheté sur épreuves et où le dernier chapitre était manquant ; ou encore de cet autre où il avait fallu bâcler le travail vite vite - fonctionnement de plus en plus prisé, en vingt ans le temps normal d'une traduction est passé de six à deux mois - en me refusant carrément les ultimes modifications que je proposais - une première pour moi ! J'en aurais pleuré - parce qu'il fallait que cela parte de toute urgence en corrections à… Madagascar ! (ou au Viêt-nam, au choix), où les locuteurs natifs du français sont légion comme on le sait, mais leurs tarifs tellement plus attractifs, n'est-ce pas. Ainsi donc, côté délocalisation, la culture n'aurait rien à envier à la fabrication de sacs ou de pantalons.
Il y a pire néanmoins.
Si, si.
Et ça c'est quand votre téléphone ne sonne pas.
Cela m'est arrivé une année durant, après avoir pourtant traduit deux best-sellers, qui m'ont incidemment valu des ennuis avec Partena et le fisc belge dont je me remets tout juste (32.000 euros à devoir à l'Etat belge, ça vous dit ? Ce serait trop long à raconter ici, mais franchement, vous ratez là un épisode palpitant d'une vie d'artiste !).
Et quand votre téléphone ne sonne pas une année durant, vous vous mettez en quête d'autre chose, vous condescendez même (mais sans droit au Cpas ou au chômage, avez-vous seulement le choix ?) à sortir de chez vous pour gagner votre croûte. Et pourquoi pas, vous aviez bien été chanteuse de rues, autrefois ?
Certes j'avais jadis tenté un cierge à l'église de mon quartier et, oh miracle, Dieu, qui a de l'humour comme chacun sait, avait dû intercéder pour que je décroche dans la semaine une traduction intitulée « Rouge à lèvres sur l'hostie »… Mais je m'étais fâchée avec Dieu depuis et dus m'en remettre au Soir, dont les voies sont moins impénétrables, c'est bien connu.
Ainsi je découvris pire que la traduction littéraire, et ce sont les textes parlementaires, que la Chambre belge me pardonne, d'un ennui colossal, pour ne pas dire abyssal. Dont je fus sauvée par une traduction du néerlandais offerte par… une jeune femme de mon passé, avec qui j'étais partie vivre aux EU à dix-sept ans et qui se retrouvait à présent directrice éditoriale à Paris !
La boucle des heureux hasards était ainsi bouclée.