FDC ? (Fallait-il démontrer cela ?) - "Un nid pour quoi faire?"
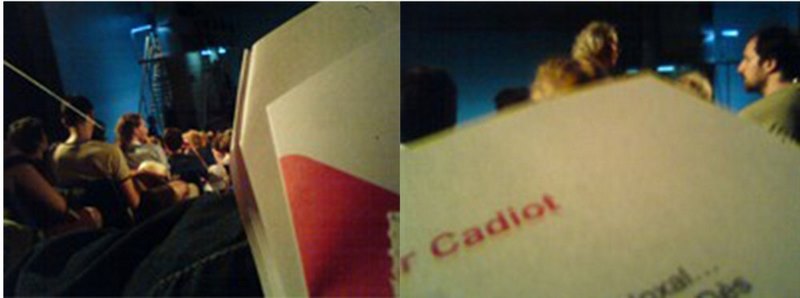
Quand, vide, mou, désabusé, au bout du bout du bout de la fuite du social, quand on a quitté la ville, pris de la hauteur (au sens propre), quand on ressent l'appel de la nature comme un besoin régressif, quand on a traversé l'Immaculé, que l'on s'est immergé de neige, dans des espaces où elle ne devient jamais sale, qu'advient-il ?
Cadiot (texte) et Lagarde (mise en scène) posent la question. Ils ne disent pas au spectateur que le personnage qui vivra cette quête initiatique se prénomme Robinson, peut-être par peur que l'onomastique ne vienne mettre à plat leur détournement rousseauiste.
Car au bout de la fuite du social, ce n'est pas la découverte de l'Homme bon débarrassé de la perversion civilisationnelle que découvre Robinson. Mais bien une micro-société ubuesque qui cumule les ridicules : un roi déchu égocentrique et sa cour vivent dans un chalet de montagne, une sorte de Richard III de pacotille entouré de courtisans pleutres. Ceux-là vivent en vase-clos, reproduisant, à l'écart de tout, un catalogue de bassesses toutes humaines, micro-pouvoirs, hypocrisies et vanités.
Ailleurs, c'est ici en pire, en somme.
Pour en rendre compte, « Un nid pour quoi faire » propose une dramaturgie étonnante, qui me semble très séduisante sur papier mais peine à convaincre sur plateau. Le narrateur, physiquement présent sur scène, ne prend la parole que par voix off. Sa pensée est ainsi dissociée de son être social. Cette voix off, calme, posée, claire et parfois poétique, est doublée d'un film, sorte de très long travelling projeté sur un immense écran en fond de scène, où les espaces se succèdent et disent la fuite vers l'ailleurs. Cette paire énonciatoire apaisante (voix off/images) reviendra cycliquement ponctuer le spectacle, fil rouge entre les tableaux. Car l'essentiel du spectacle, c'est la vie au Chalet (comme on dirait la vie au Château), les colères du roi et les lâchetés des courtisans, le déploiement de cette micro-société, probablement fantasmée par Robinson fuyant le réel. Et ces tableaux sont traités sur un tout autre mode que la narration fil rouge, dans un théâtre dramatique, de situations, usant d'un comique de jeu, d'une ludicité immédiate et souvent un peu facile, un théâtre rapide, speedé mais finalement très académique. Ce qui séduit dans cette dramaturgie, c'est l'impression qu'à la paire thématique « Société / Désir d'en sortir » correspondrait la paire esthétique « Vieux théâtre dramatique / Théâtre narratif contemporain ». Ce qui peine à convaincre, c'est l'articulation de ces deux veines. En un mot : la mayonnaise ne prend pas. Ces deux théâtres-là ont trop peu en commun pour fonctionner ensemble. Peut-être est-ce là précisément ce que tentent de démontrer Cadiot et Lagarde, auquel cas il y a lieu de s'inquiéter puisque Robinson finit roi à la place du roi, quittant la veine dramaturgique à laquelle il était associé pour assimiler celle de son prédécesseur, pétrie d'hypocrisies sociales et de ficelles théâtrales éculées. Était-ce vraiment ce qu'il fallait démontrer ?
