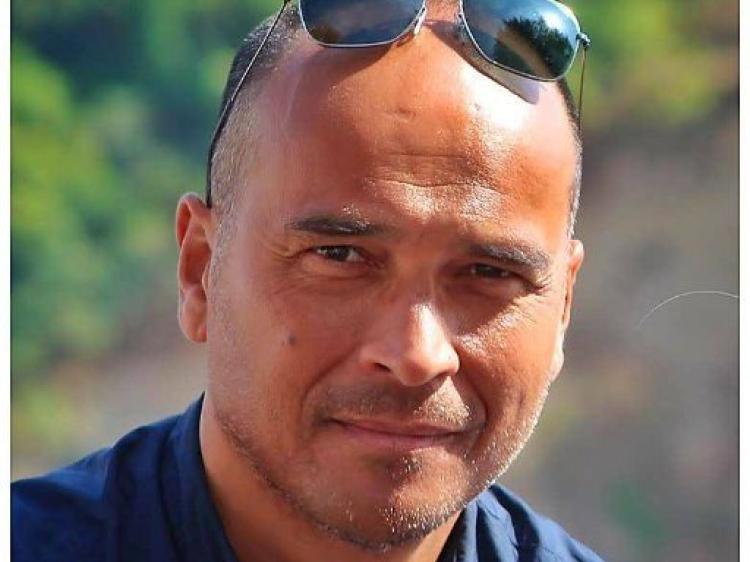Vincent (Walden) Hennebicq, Plus-Que-Vrai
Une interview volée en juillet, pendant le Festival d’Avignon au Théâtre des Doms – qui programmait Going Home, la dernière création de Vincent Hennebicq. Avant Etats d’urgence et Wilderness, à venir sur nos scènes dans les prochains mois.
Par Maud Joiret.
Ça veut dire quoi être auteur pour Vincent Hennebicq ?
J’ai la plus grande admiration pour les auteurs. Je suis un passionné de littérature, je lis tout le temps. Les auteurs sont indispensables à ma propre existence. Si la question sous-entendue c’est : est-ce que je me considère comme un auteur ? Ça non.
Pourquoi pas puisque Going Home est créé sur un de tes textes ?
Je dirais alors que je suis un auteur de spectacle. Parce que je n’aurais jamais créé Going Home sans la musique ou la lumière, le son, la scénographie. C’est vraiment un tout.
Comment se passe l’écriture ? Tu écris d’abord un texte où tu vois déjà les compositions de musique, les lumières et les voix des acteurs ? Tu te bases sur des improvisations ?
J’écris comme si c’était moi qui allais jouer, avec mon rythme, ma façon de parler et tout seul chez moi. Je mets de la musique, toujours. J’ai beaucoup écrit Going Home en écoutant Beethoven, alors que la musique du spectacle est plutôt rock. Je ne suis pas musicien mais ma vie c’est juste ça, écouter de la musique et lire des livres. Et aller au cinéma.
Souvent, il y a un compositeur associé à ce que j’écris, ou un type de musique. Pour Going Home, je savais que la musique allait avoir des influences rock mixées avec du classique – c’est pour ça que j’ai demandé à François Sauveur, qui est violoniste et guitariste, de jouer dans le spectacle. Je voulais aussi quelqu’un capable de jouer sur le contraste piano/batterie, et comme j’avais depuis longtemps envie de travailler avec Vincent Cahay, je les ai réunis au plateau. J’en étais heureux aussi parce qu’ils ne se connaissaient pas musicalement.
J’essaie surtout de raconter des histoires. De les raconter le plus clairement possible et ensuite je réécris en fonction de la musique composée pour moi. Je ne suis pas compositeur mais je sais exactement ce que je veux entendre. Les musiciens arrivent à traduire ce que je leur exprime. Ça fonctionne, on finit par se comprendre.
Le premier jour des répétitions de Going Home, j’avais honte de venir avec le texte et je n’osais pas le donner aux comédiens. Alors je leur ai raconté l’histoire dans les détails puis je leur ai demandé de me la raconter à leur tour. Ils se sont lancés dans une grande improvisation théâtrale et musicale. Beaucoup de morceaux du spectacle sont restés tels quels. Puis j’ai retravaillé un petit peu le texte à partir de leurs improvisations. J’ai fait en sorte qu’il s’adapte à la façon de parler de Dorcy Rugamba – qui est beaucoup plus raffinée que la mienne.
 « Going Home » - photo : Emilie Jonet
« Going Home » - photo : Emilie Jonet Tu avais déjà ton casting en écrivant ?
Non, mais je l’ai su assez vite. C’est François Sauveur qui m’a dit de travailler avec Dorcy Rugamba quand je lui ai raconté l’histoire. C’est vite devenu une évidence. J’avais rencontré Dorcy au Conservatoire de Liège et je l’avais vu notamment dans Rwanda 94, et Bloody Niggers!, deux spectacles qui m’ont fort marqué.
Pour Going Hom, on a fait avec eux un atelier d’une semaine autour du texte et de la musique et puis on est parti dix jours en Éthiopie. Tu te rends compte qu’il faut vite faire page blanche, parce que les images d’Epinal volent en éclat et il faut travailler avec ce qu’il y a là-bas. Par exemple, les petites coupures là-bas ont une odeur assez fortes parce que c’est des billets qui valent cinq centimes, ils passent de main en main, ils sentent les marchés, le piment rouge, l’injera… Quand on te donne un billet qui vaut dix euros, il ne sent rien du tout, il est tout net – ça donne évidemment envie d’écrire sur ce type d’expérience. Ce n’était pas prévu que j’en parle dans le spectacle, mais après le voyage, c’est devenu important d’en parler.
Et puis c’est un pays qui m’a assez vite fasciné. Un pays qui n’a jamais été colonisé. C’est un pays hallucinant, à plein de niveaux. Les mythes, la culture, l’éthio-jazz, le café…
Pour revenir sur ce qu’on disait sur les auteurs : en fait, je préfère l’idée de raconter une histoire au bord du lit. Quand je me souviens des histoires que racontait ma grand-mère, je me souviens aussi bien de la chaleur du lit que de la petite lumière qui allait sur elle, de la poussière qui volète, de la toile d’araignée qui était cachée sous le lit et qui allait me faire peur une heure après quand elle serait partie. Tout ça pour moi participe de l’histoire. C’est ça que j’essaie de recréer au théâtre. J’aime raconter des histoires parce que ça m’aide à vivre. J’ai besoin de la fiction tout le temps, sinon c’est trop dur.
Le mot « fiction » est intéressant ici, parce qu’en même temps ton spectacle est basé sur un fait réel, c’est presque un documentaire. Comment as-tu découvert le fait divers qui t’a inspiré ?
En fait c’est raconté par un avocat berlinois, Von Schirach, dans une petite nouvelle.
… Ce n’est pas du tout basé sur un fait divers en fait.
C’est une nouvelle écrite d’après sa rencontre avec l’accusé et lui est vraiment avocat. Donc… Est-ce que lui a rajouté des choses, changé des lieux ? On ne le saura jamais, en tout cas moi je ne veux pas le savoir. La question de la vérité, c’est passionnant… Je suis sûr que c’est vrai. Après, il y a des choses que j’ai ajoutées, donc fictionnalisées, comme le village d’Awra Amba que j’ai découvert en Ethiopie. Ce n’est pas dans l’histoire de l’avocat mais en y allant j’étais obligé de l’inclure parce que la manière de penser la communauté de ce village m’a fasciné. Le village existe donc bien mais je ne sais pas si lui y a déjà mis les pieds.
Tu le présentes en tout cas comme étant vrai. Tu racontes même l’épilogue en donnant des dates.
Bien sûr que c’est vrai. Chaque chose est vraie, même si j’ai écrit et développé des aspects qui n’étaient pas présents dans le récit de base… On a besoin de ce genre d’histoire, parce que sinon : qu’est-ce qu’on fait ? La première question que les gens me posent après le spectacle c’est « est-ce que vous l’avez rencontré ? » Mais je ne veux surtout pas rencontrer ce mec. Pour moi, c’est un héros. Et j’aime la métaphore qu’il représente. J’y pense tous les jours. Il s’en fout de la loi, il s’en fout des frontières, de tout le contexte dans lequel on est baigné et que tout le monde trouve insupportable. Lui, juste parce qu’il a une autre manière de réfléchir, qu’il n’intellectualise rien du tout, qu’il fonce, il vit. J’ai besoin de me dire qu’il y a encore des gens comme ça. Et je suis bien frustré de ne pas en être un. Mais ça me rassure, donc évidemment c’est vrai, c’est plus-que-vrai.
Wilderness est ton troisième projet, en préparation. Tu peux nous en dire plus ?
J’aimerais travailler sur la fuite dans la nature, raconter une histoire inspirée de mes expériences et de celles d’Arieh Worthalter. Il y a une grande partie de moi qui veut tout le temps s’enfuir et qui a besoin de grands espaces, de temps, de silence. Je suis parti pendant un mois avec une tente en Islande. Et j’ai fait le tour de l’île. Mais très vite, je suis devenu fou. Je m’étais mis dans la tête de me filmer. Mais au bout de deux-trois semaines, je me mettais à raconter n’importe quoi à la caméra, je parlais aux oiseaux… Des orages m’ont bloqué dans la tente pendant toute une journée. Je ne bougeais pas, j’étais comme une étoile de mer, pour essayer que ma tente ne s’envole pas et en même temps je me filmais. Les cassettes vidéo ont été perdues par la poste. Je pense que c’est mieux comme ça.
Arieh, lui, a vécu deux ans à l’étranger. Il est parti d’abord en Amérique du Sud, puis est passé en Louisiane pour apprendre le blues à la guitare. Il a fini par vivre dans une cabane au Canada tout seul.
En fait, j’ai l’impression qu’une fois dans la nature, il n’y a plus rien à dire. Au moment où tu prends l’avion et où tu te dis je vais aller m’isoler là, t’as un milliard de trucs à dire : les raisons pour lesquelles tu y vas, pourquoi tu vas là précisément… Et quand tu arrives en pleine nature, hé ben t’as rien à dire.
J’aimerais bien arriver quelque part à décrire ce sentiment-là. Je suis très schizophrénique par rapport à ça. Ce qui est terrible dans le fait d’être seul c’est que tu ne peux pas partager avec quelqu’un le bonheur d’être seul. Tu veux quitter quelque chose mais tu arrives dans un endroit où tu peux tout faire mais où il n’y a rien à faire. Quand on arrête de parler, à qui est-ce qu’on finit par s’adresser ? Toutes ces questions m’intéressent, parce que je crois avoir une envie d’exil, de partir, de fuir.
À la base, je suis parti en Islande parce que j’avais une fascination pour ce pays, j’étais amoureux de Björk et je me disais que là-bas il devait y avoir des trucs incroyables. Et c’est drôle, parce que je racontais ça aux gens que j’ai rencontré en faisant du stop et eux me disaient que j’étais vraiment un gros blaireau, qu’il n’y avait rien à faire là à part monter sur des volcans. Mais je trouvais ça génial. Wilderness parlera de ça. Qu’est-ce que c’est que le tourisme pour aller chercher ça ? Et qu’est-ce qu’on cherche en fait ? Est-ce que c’est une quête, une expérience ? Est-ce que c’est une fuite ? Pourquoi est-ce qu’on s’en va ? Pourquoi est-ce qu’on revient ? Ce sont des questions abyssales. Et on est dans un contexte qui est le plus fermé possible. Et qui ne correspond pas à la réalité de chaque être humain. J’ai vraiment du mal avec ça. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut fermer autant les frontières alors que tout le monde a envie de se barrer. Tout le monde a envie de ça, c’est logique. Et ça a été comme ça de tout temps et ça le sera toujours. L’homme est un animal qui bouge. Pour moi, Wilderness posera aussi cette question : comment bouger aujourd’hui ?
Quels sont tes auteurs préférés / tes cinéastes préférés ?
Il y en a beaucoup. Je lis pas mal de littérature américaine. Bukowski, Fante, Tesich… En ce moment je lis beaucoup de nature writing par rapport à Wilderness. Tout ce qui est Edward Abbey, Pete Fromm, London, Thoreau évidemment. Pour le cinéma je suis assez fan de Von Trier, d’Haneke, Sorrentino, Herzog, Bruno Dumont, mais surtout d’Ulrich Seidl, un réalisateur autrichien. Il vient de faire un film qui s’appelle Sous-sols, où il filme des sous-sols en Autriche. Voir un peu ce qui s’y passe. Il me fascine avec ses cadres, ses plans fixes, et puis il a déjà gagné des prix du meilleur documentaire pour des fictions et inversement. Ça me passionne.
Quand un auteur est accusé d’avoir inventé un truc en disant que c’est vrai ça me rend dingue. C’est ce qu’on a reproché à James Frey avec son roman « Mille morceaux » – qui est magnifique. C’est l’histoire d’un mec qui est ultra dépendant à l’alcool, à la drogue, et qui raconte tout ça dans une descente aux enfers, c’est brillant. Il le raconte à la première personne en disant que c’est son récit. C’est bouleversant. Tu pleures, tu ris, tu deviens dingue, impossible de lâcher la lecture. Il a eu des problèmes aux Etats-Unis, on lui a reproché d’avoir menti en relevant qu’il n’était pas vraiment à tel endroit, à telle date, je ne sais plus exactement… Mais qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Je ne lis pas un roman ou je ne vais pas voir un film en étant certain que c’est vrai ou pas vrai. J’adore la docu-fiction, on n’est fait que de ça. On est fait de fictions, d’histoires, on raconte des histoires aux gens, à soi, on s’invente des moments de son enfance, etc… On parlait tout à l’heure de ma grand-mère mais si ça se trouve je fantasme complètement, j’ai peut-être inventé les détails de mes souvenirs.
Tout ça pose la question de la réalité dans laquelle on veut vivre. C’est comme dans Going home. Personnellement, j’ai envie que le monde devienne un peu plus comme dans le spectacle. Si j’arrive à l’avoir pendant une heure, le temps de la représentation, c’est déjà une heure de gagnée. Pour Wilderness c’est la même chose, si j’arrive à avoir pendant une heure cette sensation d’aller vers l’avant, de pousser vers une envie de faire quelque chose d’autre, d’aller vers un vent de liberté alors j’aurai déjà gagné ça.
Tu continueras à écrire donc ?
J’ai besoin de raconter des histoires. Que ce soit les miennes ou que je le fasse en tant que comédien.
Avec Artara, la compagnie de Fabrice Murgia que tu as confondée, on sent un intérêt commun pour la technique. Qu’en penses-tu ? C’est un langage qui te parle ?
C’est plus obsédant chez Fabrice que chez moi. Il pense les spectacles aussi en images. Je trouve ça fascinant. Moi, sur chaque spectacle c’est un peu différent. Je crée toujours avec la musique, ça oui, parce que sinon, je meurs… Je crois que ça dépend vraiment de l’histoire que j’ai envie de raconter. Sur Wilderness il y aura beaucoup de technique parce que je voudrais faire entrer la nature sur le plateau, mais sur l’autre spectacle que je suis en train de mettre en scène (Etats d’urgence sur des textes de Falk Richter), il n’y en aura pas, ce sera juste du jeu d’acteurs.
L’endroit où je me sens le mieux c’est dans une salle noire, en tant que spectateur, metteur en scène ou acteur, peu importe les procédés. La scène est ma meilleure amie, elle peut tout accepter.
Tu n’as jamais eu envie d’être comédien sur tes propres spectacles ?
Si si, c’est dans ma tête, je le ferai un jour.
Est-ce que Vincent Hennebicq se sent davantage comédien ? Auteur ? Metteur en scène ? Ou « du spectacle » ?
Je ne sais pas, j’aime bien changer de casquette. Pour Fabrice Murgia, je fais de la dramaturgie, je donne cours à Liège, je mets en scène des trucs qui sont pas à moi, des trucs à moi, je suis comédien… J’aime vraiment bien naviguer de l’un à l’autre parce que je trouve que tout peut s’enrichir. Raconteur d’histoire, ça j’aimerais bien.
Est-ce que tu trouves qu’il y a des trucs qui manquent dans le métier, des appuis qui n’existent pas, des aides à inventer ?
D’un point de vue général, il y a un manque de moyens évidemment. Je n’ai pas obtenu la Capt (bourse du conseil de l’aide aux projets théâtraux) pour Going Home et c’était difficile parce que ça remettait en question le voyage en Ethiopie que j’ai finalement dû financer moi-même. Après, j’ai la chance d’être souvent soutenu par le Théâtre National, ça veut dire un accompagnement, une équipe technique… C’est pas rien. J’ai conscience de la chance que j’ai. Mais ce ne sera jamais assez. C’est logique, on en veut toujours plus. Ce qui manque le plus, c’est du temps. En fait, c’est ça l’argent pour nous. Du temps de création, du temps à être aux prises avec le plateau. Un spectacle demande tellement de temps. Going Home a terriblement changé. Là on doit être à la quarantième représentation, mais les dix premières ne ressemblaient pas à ce qu’on voit aujourd’hui. C’était dix minutes plus long. C’est monstrueux au niveau du rythme, moi qui suis obsédé par le temps, c’est dingue ! Quelque part, on n’y était pas. En cinq-six semaines de répétitions, ce n’est pas possible de créer un texte, de faire la composition musicale…
Ce qui fait aussi défaut en Belgique francophone je trouve, c’est le manque de reconnaissance des autres arts au théâtre. Personnellement, je peux parler de la musique dans mes spectacles. On n’en parle pas, ça ne se trouve presque jamais dans les critiques. On voit trop souvent le théâtre comme étant une seule chose dont on connait les codes. J’ai l’impression – mais c’est peut-être un rêve – qu’en Flandre il y a plus de reconnaissance de ça. C’est important pour moi de dire que François Sauveur et Vincent Cahay sont les compositeurs de Going home par exemple. Ça veut dire aussi que c’est un travail d’écriture en soi. C’est du théâtre musical, sans eux ce n’est pas le même spectacle.
En fait, de manière générale, je pense que décloisonner est important. Aujourd’hui, on fait des spectacles de danse où on joue, des spectacles de théâtre où on chante ou danse, du théâtre avec du cirque, des arts plastiques, je pense qu’il faut trouver les moyens pour favoriser ces nouvelles écritures et arrêter de se tenir à un cadre particulier. Un spectacle ce n’est plus un auteur, un metteur en scène et des comédiens. Il y a les vidéastes, les compositeurs, les créateurs lumière, les plasticiens, les chorégraphes, l’équipe technique, l’équipe de production, de diffusion, c’est toute une compagnie qui participe au langage particulier d’un spectacle, et c’est quelque chose qu’il faut encourager.
Democracity, le feuilleton que tu as publié sur Bela, est une autre forme d’écriture aussi. Est-ce que tu as envie de continuer l’expérience ? De publier ?
Oui, c’est un fantasme pour quand je serai vieux.
Parce que tu te sentiras plus à l’aise d’avoir beaucoup écrit pour le théâtre avant ?
Oui ! C’est difficile de me sentir un peu légitime. Mais c’est dans ma tête sans doute. Et puis j’écris une fois sur deux pour le théâtre, sinon je monte les textes de quelqu’un d’autre, ça me rassure. Et en plus, c’est quand je mets en scène les textes d’un autre auteur qu’on me donne la Capt…