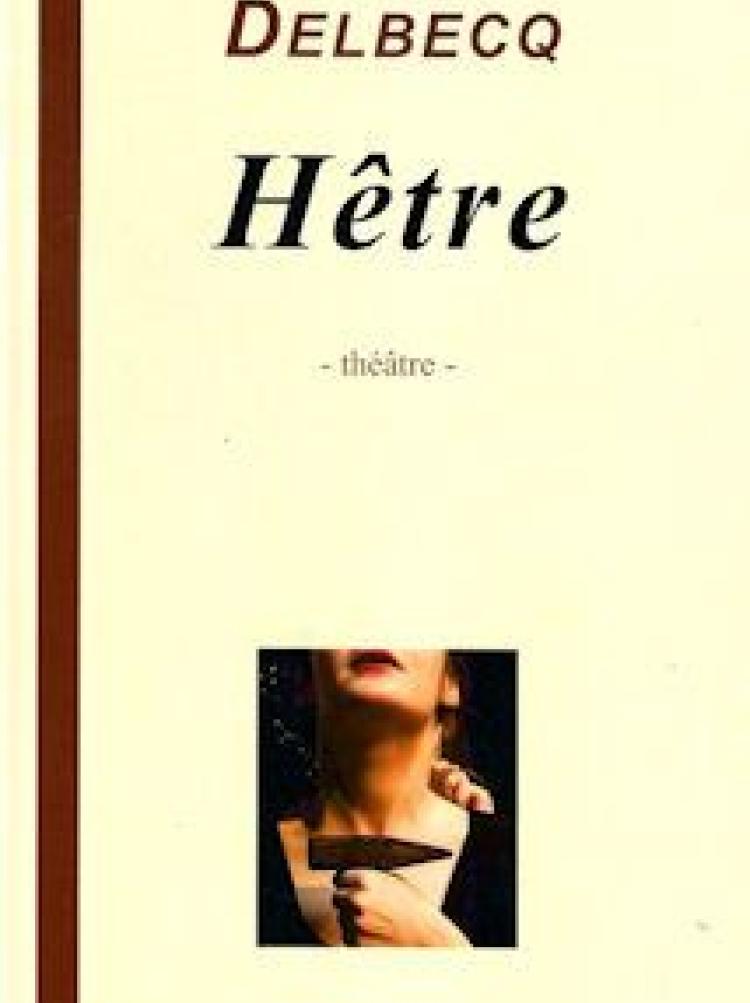C'est lui qui nous le dit
Jacques De Decker s’est prêté au jeu de l’interview le temps de poser un regard sur son parcours de « Passeur polygraphe ». Un retour enrichi par la distance…
A parcourir sur Bela, l’interview est initialement parue dans la revue Le Non-Dit, n° 90, janvier 2011.
Vous êtes académicien, traducteur, adaptateur, biographe : vous êtes un véritable passeur. Un passeur polygraphe : vous êtes aussi dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste… Peut-on en déduire que vous vous êtes longtemps levé de bonne heure ou, en tout cas, qu’une certaine curiosité littéraire vous habite depuis l’enfance ?
Oui, je crois depuis que j’ai appris à lire. Mais j’ai tardé à lire comme on l’entend communément. Des gens de ma génération en Belgique ont pris de plein fouet un phénomène culturel typiquement belge et qui s’est avéré après très important, qui est la bande dessinée. Je ne considère même pas que j’ai appris à lire dans une bande dessinée. Il faudrait inventer un verbe pour désigner le mode d’approche qu’on a d’une bande dessinée, qui comprend la perception aussi bien graphique que verbale. J’y ai été tellement immergé que, comme certains pédagogues à l’époque le craignaient, ça m’a éloigné de la lecture proprement dite. En fait, c’est une sottise parce que la lecture d’une bande dessinée est une lecture plus complexe que la lecture proprement dite. L’entraînement à ce type de lecture fait que la lecture au sens classique, c’est à dire le fait de lire des livres sans images, m’est venue assez tard. J’ai le souvenir que je devais avoir au moins dix ans avant d’avoir lu un livre de littérature classique, française, que je n’ai jamais oublié d’ailleurs, Les lettres de mon moulin de Daudet.
Mon rapport à l’écrit est un rapport médiatisé: il l’a été par le dessin, par le cinéma, par le théâtre. En fait, mes premières passions ne sont pas fondamentalement littéraires. Ça va le devenir plus tard. Dans la lecture proprement dite, hormis le rapport à la poésie, je suis plus un lecteur d’idées. Je suis obligé de l’admettre maintenant, avec l’âge, que la langue est porteuse de quelque chose d’autre. Et je pense que c’est aussi lié à mon plurilinguisme originel. Lorsqu’on a entendu très jeune beaucoup de langues autour de soi, pas seulement le français et le flamand, on a forcément une relation moins figée ou fixée sur la matérialité de la langue qu’à sa capacité de passage – vous en parliez. La langue est un véhicule d’autre chose. Je me rends compte que je suis de plus en plus attiré par la philosophie et par la musique. Le travail du rapport entre parole et musique m’intéresse énormément aussi. Dans le théâtre, j’ai toujours ressenti que la langue n’était pas une langue littéraire, qu’elle était ce que le personnage envoyait comme signes par la voix. Mais il en envoie d’autres par le corps, le geste, l’attitude, le mouvement. Il y a toujours cette relativisation de la langue et de l’écrit. Mais comme tout ça a sa trace écrite, c’est sûr que j’ai passé très tôt beaucoup de temps dans la lecture et que j’en passe toujours énormément. La lecture est quelque chose que je n’ai jamais considéré comme une besogne. C’est comme une respiration.
À 18 ans, vous avez créé le Théâtre de l’esprit Frappeur avec le (futur) metteur en scène Albert-André Lheureux. Qu’est-ce qui a initié votre venue au théâtre et pourquoi l’ « Esprit frappeur » ?
Je dois l’initiation au théâtre à deux expériences. L’une grâce à mon grand-père, qui m’a emmené voir des marionnettes de Toone originelles, celles qui se donnaient encore dans une rue près du marché place du jeu de balle. Il ne m’y a emmené qu’une fois mais on a eu de la chance, parce qu’il y a eu une tombola et j’ai gagné une marionnette – que j’ai d’ailleurs léguée à l’Esprit Frappeur des années plus tard. Cette seule et unique représentation que j’ai eue avec mon grand-père était un épisode du Bossu et a été une illumination, c’est-à-dire un sentiment d’évidence: que c’était magique, que c’était tour ce qui me ravissait. Déjà, avec ce regard qui me caractérise – on finit par se connaître avec le temps – c’est que je m’étais autant intéressé au spectacle qu’à la manière dont il se faisait. J’ai pu voir les marionnettistes, je voyais les types qui disaient le texte en lisant dans de grands grimoires et en agitant les marionnettes. J’avais tout de suite compris ce système et je trouvais ça génial, pas seulement que ça donnait un beau spectacle mais que c’était un exercice très ingénieux. Ça a donc été le premier choc.
La deuxième fois, je devais avoir une dizaine d’années, mon père, qui n’était pas du tout un amateur de théâtre (il était peintre, je crois qu’il est allé au théâtre cinq fois dans sa vie), m’emmène voir une pièce au théâtre flamand. Il était originaire de Ninove et avait connu un auteur flamand, très oublié aujourd’hui, qui s’appelle Paul de Mont dont justement une pièce se jouait. Il se devait bien d’aller voir la pièce de son ami. Là, j’ai vu mon premier spectacle de théâtre vivant, avec de vrais comédiens. J’en suis revenu absolument retourné. J’en parlais avec une effusion qui faisait rire tout le monde. Le virus était là.
Alors, j’ai commencé à faire des marionnettes moi-même, à gaines et puis à fil, puis j’ai commencé à aller plutôt au cinéma et là, j’ai une dette à ma mère. Elle était musicienne et jouait très bien du piano. Elle adorait les comédies musicales – elle n’aimait que ça, au cinéma. Vers 1950, j’ai vu les films de Stanley Donen, de Vicente Minelli, je les connais pas coeur. Ça remplace pour des gens de la deuxième partie du vingtième siècle ce qu’a pu être la découverte de l’opéra pour le dix-neuvième. C’était prodigieux, évidemment. Pas seulement les interprètes célèbres, comme Fred Astaire, Gena Kelly, qui sont pour moi des artistes prodigieux par cette espèce de fluidité hollywoodienne, c’est-à-dire cette façon de ne pas faire sentir le passage de la parole au chant, de la démarche naturelle à la danse. Tout ça m’a profondément impressionné et marqué.
Le cinéma va jouer un rôle plus déterminant – parce qu’il est plus accessible, plus à la portée de chacun, parce que je m’y investis aussi presque en érudit (je me souviens que je retenais les génériques par coeur). J’ai fait mes débuts de journalisme dans une revue de cinéma qui était créée dans notre athénée de Schaerbeek qui bénéficiait de la présence comme professeur de néerlandais d’André Delvaux. Il y avait donc un cinéclub – c’est quelque chose dont Alain Berenboom parle souvent, on était à peu près de la même promotion – on a eu une chance folle, avec des expériences comme celle-là. Le cinéma a été ma première nourriture culturelle et intellectuelle personnelle.Albert André était dans la même classe. Nous nous intéressions aux mêmes choses. On allait beaucoup au théâtre ensemble. Lui avait vraiment ressenti très fort la vocation d’acteur. Il se trouvait qu’il habitait à la limite de Schaerbeek et de Saint-Josse, dans une maison assez vaste parce que son père avait un laboratoire de cinéma, de développement de films. Sous la maison, il y avait une immense cave voûtée. Nous nous y trouvions un jour et on avait entendu parler des petits théâtres de la rive gauche, qui se trouvaient dans des caves ou dans des greniers et on s’est dit qu’on allait faire un théâtre là. Alors pourquoi on l’a appelé l’Esprit Frappeur, c’est une très longue histoire – je vais la résumer en une phrase: l’Esprit Frappeur, c’est une blague d’élève, d’athénée, qui alimente d’ailleurs encore la légende de l’athénée de Schaerbeek. C’est un canular, en fait. On a repris ce nom – je suis d’ailleurs très fier de pouvoir dire que c’est moi qui ai eu l’idée.Et ça a bien marché, parce qu’on était en 62-63 et il y avait à ce moment-là les tous premiers signes d’un théâtre alternatif. Le théâtre à Bruxelles, c’était le théâtre du Parc, le théâtre National, le Rideau de Bruxelles, le théâtre Molière, le théâtre du Vaudeville et le théâtre des Galeries, et c’était tout. Il n’y avait que des grands théâtres si on veut, il n’y avait pas d’avant-garde. Venait de se créer le théâtre de Poche. Il y avait de la place. On a fondé un théâtre comme il y en avait à Paris et à Londres et ça a intéressé les journalistes. On était amateurs en réalité, mais on a eu un déferlement médiatique inattendu. Ils étaient curieux de voir cette production à Bruxelles – ce qui a professionnalisé ce que nous faisions. Je n’ai pas pris cette voie-là pour des raisons que j’ai racontées dans le livre sur les Anciens étudiants de l’ULB, où je m’étais demandé si j’allais entrer à l’Insas qui se créait tout juste ou si j’allais faire comme Delvaux, faire des études de germaniques et puis m’occuper de spectacles, ce que j’ai fait. À ce moment-là, j’avais joué un certain temps La Cantatrice Chauve et puis j’ai dû m’arrêter mais j’ai continué à m’occuper de tout ce qui était texte dans le théâtre. Et ça m’a appris, tout doucement, à écrire sur les pièces, à faire des textes de programme, à faire des communiqués de presse aussi. Je faisais attaché de presse à l’époque, de la même manière qu’on le fait aujourd’hui sauf que c’était totalement artisanal. Par exemple, je m’étais planté à côté de la radio, des journées entières, et j’avais noté les heures de passage des émissions, les émissions et les gens qui les présentaient. Puis, j’étais allé à Flagey et dit à l’accueil que je voulais voir M. Untel, Mme Unetelle… et l’huissier était tellement déconcerté qu’il m’a envoyé dans les bureaux !
Je suis très reconnaissant à cette expérience théâtrale, parce que ça m’a permis de contrebalancer le rapport, disons, scolaire qu’on peut avoir au théâtre (à l’école, en lisant les grands classiques) par une pratique immédiate. Je crois que c’est une de mes façons de fonctionner – c’est-à-dire que je suis quelqu’un des coulisses, je ne suis pas quelqu’un des plateaux. C’est venu très tôt dans mon comportement. J’ai vu des tas d’acteurs, des jeunes, des débutants. Ils font vraiment partie de ma famille affective. Je ferai un jour un livre sur les acteurs parce que je les adore. Mais je n’étais pas acteur, parce qu’il y a deux choses que je ne sais pas faire, et ça fait toujours rire les acteurs quand je leur dis ça c’est, d’abord, apprendre un texte par coeur, en tout cas certainement pas une pièce entière, c’est exclu. Ils me disent que je suis complètement fou parce que la mémoire de l’acteur n’est pas celle qui consiste à ressasser simplement un texte, tout ça s’apprend dans le mouvement, dans la création du spectacle, avec des repères de toutes sortes, les partenaires sont là,… Ce n’est pas du tout idiot, la mémorisation de l’acteur. L’autre chose les fait encore plus rire, c’est que je leur dis que je ne peux pas me répéter. Ils me répondent que j’ai encore rien compris, qu’une représentation n’est pas l’autre, tout les soirs, c’est différent. Ils me disent que s’ils avaient l’impression de se répéter, bien sûr qu’ils ne supporteraient plus. Il y a peut-être un stade, quelquefois, dans les très longues séries, où les acteurs en ont assez. Mais il faut beaucoup de séries, parce que tous les soirs, les spectateurs sont différents. Les gens qui font ce métier ont un sixième sens qui fait qu’ils voient tout de suite à qui ils ont à faire, ils modulent en fonction de ça – enfin, ce n’est jamais monotone. Mais bon, ces deux préjugés ont fait que je n’ai vraiment pas senti que c’était ma voie donc j’ai pris un grand détour. Je suis passé par les études que j’ai faites pour me familiariser avec des langues qui étaient des grandes langues de théâtre -l’anglais et l’allemand-, pour revenir au théâtre par la traduction.
Qu’est-ce qui déclenche chez vous l’écriture d’une pièce, d’une nouvelle, d’un roman ? Quel est l’élément qui détermine la forme que prendra votre texte ?
C’est une question très intéressante parce qu’elle m’a toujours préoccupé moi-même. Je me la posais déjà quand je regardais travailler mon père. Comment se fait-il qu’il sache à l’avance quel format aura sa toile ? Pourquoi est-ce que là où il va peindre une nature morte, pourquoi se dit-il brusquement qu’il va faire ça sur 1m10 ? Pourquoi est-il devant un paysage vaste dans les Ardennes et fait-il un format 60×40 ? Comment ça se fait ? J’ai toujours pu observer qu’il y avait très peu de doutes là-dessus. Je ressens ça un peu de la même manière, c’est-à-dire qu’un sujet impose sa forme. Le sujet impose sa distance – son souffle (il y a d’ailleurs des volumes de textes très variés dans Modèles réduits). Il y a évidemment des formes plus ambitieuses et plus exigeantes que d’autres. Le roman, par exemple, c’est quelque chose à quoi je n’ai osé m’attaquer qu’à presque 40 ans. L’entreprise m’impressionnait.
Le rapport entre théâtre et prose est assez évident. Le seul accident que j’ai eu m’a amené au roman. Comment ai-je pu écrire un premier roman alors que rien jusque-là ne m’y destinait ? J’avais écrit des pièces et j’avais un projet de pièce particulier qui venait d’une admiration éperdue que j’ai pour une pièce existante qu’est La ronde de Schnitzler. Pour moi, c’est une œuvre incontournable, un diamant absolu de la réussite du fond et de la forme. Je voulais faire une pièce sur le même modèle parce qu’il me paraissait possible de prouver que le schéma de Schnitzler était comme un schéma prosodique. C’était comme un sonnet, ou une ronde, un rondeau, disons. Donc que je pouvais faire une pièce où il y avait chaque fois deux personnages qui se retrouvaient et l’un des deux seulement changeait et puis ils permutaient. Mais j’avais écrit une pièce (qui s’appelait dans son premier état Epiphanie) qui ne trouvait pas acquéreur. Or, j’ai toujours été très gâté, j’ai toujours pu passer de la conception à l’exécution assez vite. La première pièce était une commande, la deuxième aussi, et là, non. Il n’y avait donc personne qui l’attendait et elle ne se montait pas. Elle avait été écrite en 80 et n’était toujours pas montée en 83 – ce qui était très long à mes yeux, insupportable. Mais tant qu’elle n’était pas montée, elle n’était pas finie. C’est une conception que j’ai un peu abandonnée maintenant avec l’expérience mais qui me reste quand même très ancrée. Une pièce n’est finie que quand elle est jouée. Le texte n’est jamais que le prétexte au sens précis du terme, donc une pièce ne s’accomplit que jouée. J’étais très embarrassé parce que cette idée me hantait mais je n’arrivais pas à m’y mettre parce que je ne parvenais pas à régler mes comptes avec la précédente. Et c’est comme ça que, pratiquement sous la plume, la première scène de La grande roue est devenue de la prose. Je n’imaginais pas écrire une didascalie, un décor, parce que ça pouvait très bien ne pas se passer, en plus. C’est comme ça que j’ai écrit le premier roman. La grande roue, si l’on y regarde de près, c’est un concept très simple et qui, d’une certaine façon aussi, simplifie l’écriture. Une des difficultés qu’on a dans le roman, me semble-t-il – ça prouverait peut-être que je ne suis pas un vrai romancier, ce dont je suis assez persuadé – c’est la question de la persévérance. Et aussi, de la capacité d’autonomie d’un personnage sur la durée d’un roman. À ce stade-là, je n’imaginais pas du tout que j’étais en mesure de faire durer un personnage sur la longue distance. La formule induite par Schnitzler permettait d’abandonner le personnage et de passer à un autre. L’entreprise s’en trouve facilitée. Et puis, je crois que mon idée initiale n’était pas réalisable au théâtre. Dans la pièce de Schnitzler c’est très simple, ce sont des rapports sexuels, il y a un seul motif, un seul mode de conclusion si on peut dire, tandis qu’ici, ce n’est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais montrer que cette complexité de psychologie et d’attitude liée à l’interlocuteur, au partenaire, ne se jouait pas tellement sur le terrain ni de la sexualité, ni de la vie amoureuse, mais aussi dans l’amitié, dans le travail collégial, dans le rapport simplement à des voisins de paliers ou que sais-je… C’était très difficile à réaliser théâtralement. La grande roue a été trois fois l’objet d’adaptations de cinéma qui n’ont jamais abouti. Il y a eu une tentative théâtrale envisagée par un metteur en scène qui s’y est perdu. Il se disait qu’il devait suggérer des environnements trop diversifiés. En plus, ce ne sont pas de simples scénettes. Les rapports entre les personnages s’étendent parfois longtemps dans le temps, ou se passent à des endroits différents. C’est vrai que, quand on se met au roman et quand on a travaillé dans le théâtre où on s’est imposé toutes ces règles, qu’on a joui presque de ces contraintes, le roman est une libération formidable dont on ne s’empêche pas de jouer – c’est trop tentant !
Quelle est, selon vous, la valeur de la critique littéraire actuelle ? Possède-telle encore une valeur de légitimation ? Ou, dans la masse des publications actuelles, le critique permet-il seulement de donner un peu de visibilité à un ouvrage ? Et les blogueurs ne sont-ils pas en train de prendre le relais, en réinventant le genre de la critique ?
Je répondrai d’abord à la fin. Je ne lis pas les blogueurs, ça me tombe parfois sous les yeux sous une forme directe ou indirecte. Je suis évidemment convaincu de leur prééminence et de leur supériorité future pour une raison simple: ils écrivent autant qu’ils veulent.
Qu’est-ce qu’on attend d’un critique ? C’est d’abord qu’il aille le plus loin possible dans la lecture – je ne vais pas dire l’analyse, mais au moins dans la lecture, et puis qu’il fasse état de ce que ça lui inspire, qu’il développe sa pensée, etc. Parfois, je me moquais de textes critiques qui dépassaient de loin en volume l’oeuvre qu’ils critiquaient – prenez par exemple Le cimetière marin de Valéry: il a suscité un million de fois plus de signes de commentaires que ce qu’il comprend, mais c’est normal. La critique est une technique d’efflorescence, de développement pour ainsi dire à l’infini de ce qu’un texte peut susciter. Donc, ce que l’on impose à la critique aujourd’hui, dans les publications, est criminel. C’est en train de tuer le genre. Quand on compare ce qu’est la critique aujourd’hui avec ce qu’étaient les feuilletonistes dans Le Monde qui, dès son apparition, avait des pages littéraires comportant qu’on appelle feuilleton ou rez-de-chaussée, on est pris d’un certain vertige. Le rez-de-chaussée a été tenu par des gens bien, notamment Bertrand Poirot-Delpech. Ils pouvaient développer entre 6000 et 8000 signes – ce qui n’est pas encore l’infini, mais c’est déjà très bien et ce n’est plus pensable aujourd’hui. En tout cas, dans la presse française. Là aussi, il y a quelque chose qui apparaît d’autant plus clairement qu’on peut faire un peu de comparatisme. Si vous prenez un journal comme le Zeit allemand, vous avez des compte-rendus d’un livre qui peuvent occuper une page entière du journal – ça ne gêne pas. Évidemment, ils ont une production moins abondante, beaucoup plus sélective, mais au moins le travail de commentaire peut se déployer réellement. Aujourd’hui, je ne vois pas beaucoup d’exceptions, sinon La quinzaine littéraire par exemple, où on puisse vraiment aller jusqu’au bout ou ce qu’on croit être le bout de ce qu’on a à dire, ou à développer surtout, à penser sur un livre. Donc s’il y a quelque part une voie, une issue, elle est sans doute dans ce que permet le numérique. Cela dit, il faut aussi une sélection mais où est-elle, quels en sont les critères? Là, il s’agit plus d’un rapport entre le producteur et le consommateur, c’est-à-dire entre l’auteur et l’audience, qui font que les gens vont plus se diriger vers certains blogs. Et certains d’entre eux acquièrent maintenant une importance presqu’institutionnelle – le fameux supplément à l’Observateur qui n’existe que sous forme de site en est un signe. Et il y a une espèce de loi de la nature qui fait que le meilleur s’impose. C’est normal.
Mais, en tout cas, l’âge d’or de la critique journalistique est révolu depuis fort longtemps. Il y a une chose paradoxale… À la fin du dix-neuvième, début vingtième, un livre pouvait tirer au maximum à mille exemplaires. Publié à Paris, un livre d’un auteur un peu renommé faisait l’objet à un rythme accéléré de quinze, vingt papiers dans les journaux – mais c’était le seul et unique moyen de communication qui dominait à ce moment-là le marché. C’était une forme écrite imprimée homogène par rapport au livre lui-même. La critique a vraiment perdu beaucoup de plumes, c’est le cas de le dire, depuis ce temps-là. Elle en acquiert d’autres maintenant – je suis prêt à adhérer à ça. Mais il n’y a pas que la critique journalistique. Butor a un jour dit qu’il y avait au moins trois types de critiques: à ondes courtes (journalistique), à ondes moyennes (de périodiques plus long, comme les revues), à ondes longues (essayistique, qui paraît sous forme de livre et qui est soit exclusivement le travail d’essayistes, soit d’écrivains qui font du commentaire littéraire). Je trouve qu’on perd du terrain à ces trois niveaux mais pas pour les mêmes raisons. Le journaliste a de moins en moins d’espace, doit faire preuve de plus en plus de rapidité et faire face à la confusion entre l’information et la communication – voire, la prescription, c’est un mot que je déteste, mais on l’utilise tout le temps. Il y a deux types de critique à ondes moyennes: les magazines grand public, type Magazine littéraire, mais qui sont quand même un peu contaminés par ce que je viens de décrire, et il y a les revues plus savantes – et là, on subit terriblement la contagion d’un âge soi-disant d’or de la critique, qui est celui des années 60-70, où la critique théorique, presque incestueuse, a pris des proportions folles. Ça devient du commentaire pour le commentaire, une recherche de vérification dans le texte d’idées préalables à la lecture, qui sont souvent très grillées sur le plan idéologique. Cette critique-là ne laisse pas assez la place à ce qui me paraît indispensable à la troisième critique à savoir la critique à ondes longues. C’est une critique de complice, de gens du métier. Quand Virginia Woolf fait de la critique (elle en a fait d’ailleurs, à ondes courtes dans le Times Literary Supplement), c’est quand même autre chose… Elle en parle de l’intérieur. Je pense que la critique à ondes longues est une critique dans laquelle on sent vibrer autant celui qui l’écrit que le texte dont il rend compte. Pol Vandromme est un exemple de ça en Belgique. Il avait un style fantastique, travaillait très fort à l’intuition, et du coup il y avait des trouvailles, des pépites, des éclats prodigieux dans ce qu’il faisait. On avait des gens de ce genre aussi en France, dans la continuation de ce que pouvaient être les grands chroniqueurs, quand Théophile Gauthier ou Baudelaire se mettaient à faire de la critique, c’était ça!
Je ne pense pas qu’on puisse dire que ça a disparu de nos usages, parce qu’aujourd’hui je trouve des exemples de critique comme je les aime dans le domaine du cinéma, par exemple. Dans les revues de cinéma spécialisées, il y a des choses magnifiques de pénétration, de profondeur, de jeux de référence, etc. Il se pourrait que ce qui rend la critique dite littéraire plus malaisée aujourd’hui, c’est peut-être sa trop grande proximité avec l’objet de son propos. D’une certaine façon, un roman, c’est de la littérature et le critique c’est aussi de la littérature, d’un autre type, mais on reste dans le champ du littéraire. Il y a même une très belle définition du journalisme en général de Borges, que je cite tout le temps : « le journalisme, c’est de la littérature qui se dépêche. »Je suis inquiet aussi devant le fait que, si on peut écrire de si profonds articles sur des films, quand on voit la qualité de commentaires que peut susciter le sport, on est en droit de se demander si la littérature occupe encore la place que l’on croit. Il y a des compte-rendus sportifs qui m’éblouissent : d’abord c’est compétent, c’est sérieux, c’est scrupuleux, et puis souvent c’est très bien écrit, très agréable à lire. Mais je crois aussi que, si vous faites un compte-rendu d’un match, ce match s’est passé. Si vous faites un compte-rendu d’un livre, vous pensez à la carrière que fera le livre. C’est ça qui met le vers dans le fruit. C’est de là que vient le mot « prescription ». La critique n’est pas là pour faire la publicité du livre, elle est là pour aider à la lecture du livre.
Dans le comportement du critique, en tout cas dans le mien, se dessine une certaine forme de schizophrénie. D’un côté, j’ai lu tous les livres, avec l’âge, et de l’autre je voudrais toujours être le jeune homme qui découvre. Je reconnais que je pratique assez volontiers ce dédoublement. Ce n’est pas la peine d’essayer de parler à quelques milliers de lecteurs potentiels d’un livre qui en intéressera dix dans le champ du réel, c’est absurde. Au contraire, il faut faire des efforts. Se dire que si un livre qui n’est pas simple, mais qui peut vraiment apporter quelque chose, même à des gens qui ne sont pas tout à fait préparés il faut tout faire pour les préparer, pour que le pont soit jeté, qu’on enjambe un peu l’hiatus et on aura rendu service. Cette idée de service, pour le journalisme, j’y insiste, est une chose fondamentale. On n’est pas là pour faire la roue, on n’est pas là pour faire son numéro, ni pour démolir à plaisir, on est là pour rendre service.
Cela dit, mon rapport personnel à la critique est assez inattendu, dans la mesure où, par exemple, j’ai fait de la critique littéraire, puis de la critique de théâtre, j’ai fait un peu de critique de cinéma… J’ai travaillé pour un homme de théâtre éminent, Claude Etienne, le fondateur du Rideau de Bruxelles. J’ai fait deux-trois adaptations pour lui, qui me disait qu’il trouvait mes critiques littéraires très bien et que je devrais faire de la critique théâtrale. Je lui répondais que j’aimais trop le théâtre pour ça. Parce que l’excès de passion peut aussi être un obstacle. On ne parle pas à ses pairs, aux gens du métier, on parle à ces autres personnes encore. J’ai dû me dégager de cette folie du théâtre pour en parler de cette manière-là. En littérature, je pouvais le faire parce qu’elle m’intimidait beaucoup plus que le théâtre. J’étais de plain-pied dans le théâtre et je me disais que je n’allais pas empoisonner au sens précis ma relation au théâtre par la démarche critique. Et puis, j’ai été obligé de le faire parce qu’il y a eu un remplacement à assurer. Forcément, j’avais un bagage que les débutants n’ont pas. Je crois que j’ai fait mes premières critiques de théâtre à trente ans passés, avec douze ans de pratique théâtrale dans les jambes. Tout un apprentissage était fait et a pu être mis en pratique assez rapidement. La critique théâtrale est une technique très particulière dans la mesure où on peut se faire une culture littéraire tout seul dans une chambre. Aujourd’hui, on peut faire la même chose en cinéma, en musique, en peinture ! On peut se promener au Louvre chez soi, avec un dvd. Tandis qu’au théâtre, rien ne remplace la présence physique. Donc, on n’a jamais que l’occasion de voir un spectacle par soir, et pas de feuilleter dix livres. Une soirée, c’est une partie importante de la vie, et j’en ai sacrifié beaucoup trop à ça, par rapport à la vie en général. C’est vraiment une discipline très exigeante, mais indispensable. Si on n’a pas cette mémoire de l’expérience réelle, on se sait pas très bien comment en parler, surtout utilement. C’est un métier particulier. Les meilleurs critiques sont des gens qui, au moins pendant une partie de leur vie, se sont sacrifiés à ça. Moi je sais que je me suis sacrifié à ça puisque j’ai arrêté au moment où j’ai eu un très gros accident de santé qui était vraiment lié l’épuisement dû à ce mode de vie. Comme je réagissais à la vision d’un spectacle comme je réagis à la lecture, en me disant que ce n’était pas un travail, je ne me rendais pas compte que j’ajoutais à une journée de travail une soirée de travail. Et pourtant c’était le cas.Le statut merveilleux du critique c’était dans les grandes années, je ne sais pas si c’est encore le cas aujourd’hui, à Londres, ou à New York, où un critique de théâtre était quelqu’un que le reste de la rédaction ne voyait jamais, sauf s’il se présentait au verre de l’amitié de quelqu’un ou aux fêtes de fin d’année. Il n’était jamais là parce qu’on considérait qu’il faisait son métier en allant voir les spectacles. Au début, quand il n’y avait pas la technique, un grouillot arrivait à deux heures du matin chez lui prendre le papier et le conduire à l’imprimerie. Maintenant, on peut le faire beaucoup plus facilement, bien entendu. Mais il ne faisait que ça. Tandis qu’en Belgique, ça n’a jamais été le cas. En France, ça a été un peu le cas. Il y a une sorte de suspicion qui pèse sur les critiques dramatiques, où les autres collègues du journal disent qu’il sort le soir pour rien et qu’en plus il est payé pour ça ! Ils ne le disent jamais à propos des sportifs.
Et pourquoi pas la poésie ?
J’ai une première réponse, qui rejoint un peu ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est que mon rapport à la langue, à ma langue d’expression littéraire, n’est pas suffisamment ontologique. Comme je n’ai pas appris à parler en français, que j’ai appris cette langue à l’école, des mots essentiels chez moi, « porte », « miroir », « escalier », existent d’abord en flamand. Donc, des mots de base. Et c’est avec ces mots-là qu’on fait de la poésie. Ce n’est pas avec des mots abstraits. Il faut vraiment avoir dans le sang, dans ses fibres, ces mots essentiels.
La deuxième réponse, c’est que je pratique un peu la poésie. J’adore la poésie très classique. Je connais la prosodie française sur le bout des doigts, je l’apprenais aussi par cœur quand j’étais gamin, dans des pages du Larousse. J’adore me demander si on fait ou pas l’élision.C’est une poésie que seul William Cliff aujourd’hui peut encore faire, parce qu’il a une manière absolument géniale de le respecter et d’en jouer en même temps. Il peut se le permettre et il le fait admirablement.
La troisième raison, c’est que j’ai fait des textes de nature poétique, comme par exemple le livret de L’éveil du printemps, mais je l’ai fait en allemand, parce que la matérialité de la langue, qu’on doit ressentir très fort quand on fait de la poésie, je la ressens plus à ce niveau-là. Quand on écrit un livret, comme en poésie, ou même au théâtre, chaque syllabe compte, puisque chaque syllabe correspond à une note, donc il est très important pour le musicien de faire un mot, un certain mot, dans un certain endroit de la phrase. Pour moi, c’est plus facile à faire en allemand, qui est une langue à accent, assez nette, qu’en français. D’ailleurs tout le monde le reconnaît, c’est un mystère, le français est une langue ingrate pour l’opéra, très bonne pour l’opérette, excellente pour la chanson. On le constate, on l’admet, et on ne l’explique pas. Peut-être qu’un jour on y arrivera.
Peut-être qu’il y a aussi une quatrième raison. Je n’ai sans doute pas encore atteint un degré suffisant d’intimité avec moi-même. En tout cas, d’intimité communicable. Je crois que la grande poésie est une poésie où on fouille assez profondément dans ce qu’on a de plus singulier. Or, ce n’est pas ce que je fais quand j’écris. Je parle plus des autres que de moi, j’invente des personnages dans des situations, j’en observe ou j’en décris ou j’en raconte, mais je parle très peu de moi. Je suis encore à un stade où je ne me considère pas comme très intéressant. Mais je n’ai pas non plus de rapport conflictuel avec moi-même. Je n’ai pas d’immense névrose trop obsédante, donc je ne vois pas ce que je mettrais dans la poésie. J’ai passé l’âge d’écrire des poésies d’adolescent. Ce que je faisais quand j’étais très jeune, et où j’ai excellé, c’est les fables.
Victor Chklovski dit dans Technique du métier d’écrivain : « Pour pouvoir écrire, il faut avoir une autre profession, hormis la littérature, parce qu’un professionnel, quelqu’un qui possède un métier, décrit les choses à sa manière propre, et c’est cela qui est intéressant. » Pensez-vous également qu’un second métier soit un passage obligé pour tout jeune écrivain et un second métier a-t-il d’ailleurs épaulé votre création personnelle ?
Je n’ai exercé que des « seconds métiers » traditionnellement voisins de la littérature, que ce soit enseignant, journaliste, ce sont des métiers immédiatement périphériques à la littérature. Mais il y a un point sur lequel je lui donne raison et qu’il ne dit pas clairement, c’est qu’il faut surtout éviter que l’on doive vivre de la littérature. Pour des millions d’appelés, il y a un ou deux élus. La tentation est grande à ce moment-là d’adapter son talent à des besognes qui trahissent sa vocation première. L’aventure d’Amélie Nothomb ne peut pas arriver à tout le monde. Ce qui s’est passé est totalement miraculeux et n’est pas un exemple même si elle a suscité d’innombrables vocations. Il n’y aura jamais de seconde Amélie Nothomb dans ces proportions-là. Cela dit, je pense qu’il vaut mieux, à la limite, si c’est possible, avoir un métier différent de la littérature. Mais là, je dis tout de suite que c’est de moins en moins praticable de nos jours. Joseph Conrad n’aurait pas écrit cette œuvre s’il n’avait pas été médecin et navigateur. Et ça a lui apporté une ampleur, une profondeur dans le rapport à l’humain, une ampleur de vue au niveau de l’espace qui donne une force immense. Je pense que Tchekhov était profondément médecin. Mais je fréquente des médecins ; je n’en connais pas un qui trouverait encore aujourd’hui le temps d’écrire. C’est un des grands problèmes de la vie actuelle : ou bien est un chômeur intégral, mais c’est assez difficile d’écrire en même temps et ça ne met pas tout à fait à l’aise sur le plan mental au point d’être tout à fait disponible à l’écriture ; ou bien, on travaille et on est pressé à un tel point qu’on ne peut pas écrire.
Je discutais avec quelqu’un de l’extraordinaire, me disait-il, désintéressement des fondateurs de la NRF. Il me disait que ces gens-là ne faisaient de concessions à personne. Mais ils étaient tous soit rentiers (Gide, Schlumberger, Rivière, Martin Du Gard) soit hauts fonctionnaires (Saint-John Perse, Paul Claudel). Et c’est fondamental. La combinaison entre le rapport à la profession et l’écriture est quelque chose je crois que chacun doit régler pour soi, sans idées préconçues, sans préjugés. Il y a des métiers compatibles, mais on n’y pense jamais. On croit qu’un métier littéraire doit aller de pair avec un métier intellectuel. Je ne pense pas. Bernard Tirtiaux fait des vitraux.
Le rapport à l’argent est très simple, Julien Green l’a très bien défendu : il faut en avoir assez pour ne pas devoir y penser et pas trop, pour ne pas devoir y penser non plus. L’argent est un outil et puis c’est tout. Si on pense rapport au métier par rapport à l’écriture, ça veut dire un rapport économique et il faut le voir de façon la plus sereine possible. J’aimais beaucoup le fait que Kafka et Pessoa étaient de petits employés. Kafka était juriste mais il faisait surtout des petits contrats dans une compagnie d’assurance. Pessoa faisait de tous petits trucs, essentiellement des traductions, dans une boîte commerciale à Lisbonne. C’est peut-être ça l’idéal, un métier pas trop absorbant, qui assure l’ordinaire, qui laisse du temps et qui ne soit pas non plus susceptible de troubler la relation au reste de la société. Il vaut mieux pas un métier trop en vue, même s’il y a des hommes politiques écrivains mais il y a toujours le problème de concilier les deux.
Vous avez repris la revue Marginales en 1998 dont la ligne éditoriale est de faire émerger la fiction à partir de thématiques issues de l’actualité. D’où est née l’envie de reprendre la revue d’Ayguesparse et quels rapports entretenez-vous avec l’esprit si particulier de la revue ?
J’ai eu d’abord le bonheur de connaître Albert Ayguesparse. J’avais collaboré à Marginales, j’avais même pu grâce à lui diriger des numéros spéciaux, sur Ghelderode et Gracq. C’était le tout premier numéro paru sur Gracq. J’étais donc très attaché à Marginales et triste que la revue s’arrête même si je comprenais très bien qu’Albert l’arrête puisqu’il avait 92 ans je crois. Mais comment la faire redémarrer? C’est allé de pair avec une autre préoccupation, plus liée à l’état d’esprit dans lequel on était dans les années de milieu et de fin du vingtième siècle en Belgique, où on entrait dans une phase où nous sommes encore, une phase de redéfinition, d’errance, et dans laquelle je n’entendais s’exprimer que des politiques, des journalistes, ou alors des experts… Je me disais qu’il fallait que les écrivains parlent de ça, mais sans les obliger à adopter les techniques des experts, des journalistes ou des politiques. Ils peuvent rester dans leur créneau. J’en avais discuté avec deux confrères journalistes, sur le fait d’imaginer un newsmagazine mais qui ne pouvait pas être un hebdo parce que c’était trop rude et qui ne serait confié qu’à des écrivains. C’était de l’utopie totale, on a abandonné très vite. Mais les deux idées se sont combinées. Ca s’est passé au moment de l’affaire Dutroux. L’idée a véritablement pris forme le jour de l’évasion de Dutroux. J’en avais déjà discuté avec Luce Wilquin et, ce jour-là, on avait un fait divers mais qui était tellement romanesque, qui parle tellement à l’imagination, que c’était le moment parfait. On a lancé le thème, avec la première lettre d’invitation en se disant qu’il fallait sortir ça très vite. Et ça a donné « La grande petite évasion ». Après, on a gardé ce rythme trimestriel. L’idée force c’est le point de vue du créateur sur l’actualité. Je pense qu’on a réussi certaines choses et celle dont je suis le plus fier au nom de toute la revue et de toute l’équipe, c’est le numéro sur le 11 septembre. Parce qu’un jour il s’avérera, et on vérifiera que c’est la première répercussion littéraire de cet événement. Dieu sait si on en a parlé depuis, pas un seul écrivain américain n’en a pas parlé, énormément d’écrivains dans toutes les littératures en ont parlé, mais la toute première déclinaison c’est Marginales, Bruxelles. Avec des textes fantastiques.
Piemme dit, dans Comme un Manifeste : « Je lis le journal. Mon théâtre commence là: dans le journal, dans la jungle des événements qui surgissent – que j’y sois où que je n’y sois pas. » Pourriez-vous vous approprier ce discours ?
Pas vraiment parce que je suis journaliste. Pour moi le journal n’est pas un relais, c’est un outil que j’ai contribué très activement à fabriquer pendant des années et dont je me suis éloigné maintenant. Mais j’ai une lecture du journal qui ressemble à la façon dont je regardais les marionnettes quand j’étais gamin : je ne crois pas une ligne de ce que je lis. Je lis le journal avec l’œil d’un professionnel, je sais parfaitement comment c’est fait, je vois le titre et l’auteur et me dis que ça va donner ça, et j’aime bien être surpris, surtout agréablement. Mais en général, c’est assez attendu. Je crois que le journalisme est indispensable mais ce n’est jamais qu’un filtre dans lequel passe l’événement. L’avantage d’avoir fait du journalisme professionnel c’est qu’on a été sur l’événement, sur le terrain.
Cela dit, je comprends tout à fait la démarche de Jean-Marie parce qu’il est un lecteur enragé de journaux, et malgré sa très grande intelligence et son immense culture, il reste néanmoins un lecteur innocent de journaux. Même s’il a suffisamment une bonne grille notamment idéologique pour voir aussi à quoi il doit s’attendre mais il se situe plutôt au niveau des idées que sur la technique même. Donc, je pense que le journalisme aide l’auteur, d’abord à apprendre à écrire, indiscutablement. Et deuxièmement, à faire la différence entre ce qui est médiatisé et ce qui ne l’est pas. Si j’ai envie de comprendre pourquoi dans les Modèles réduits je ne parle que de choses infinitésimales, qui se passent dans la vie de tous les jours et la plupart du temps à Bruxelles, c’est parce que je ne suis pas un globe-trotter et que je ne veux pas parler de première main de la panique dans une ville irakienne bombardée. Je ne serai jamais Norman Mailer. L’écrivain parle de ce qu’il sait, enfin je crois. Il doit parler de ce qu’il observe et je n’ai pas un champ d’investigation très vaste. Je n’ai jamais été grand reporter, ou alors une fois par hasard, et je n’ai jamais terminé d’écrire ce que je devais dessus.
C’est une question pertinente parce qu’elle signale bien la différence. Quand certaines personnes lisent les petites histoires de Modèle réduits, elles s’étonnent un peu du fait que je parle de choses finalement aussi dérisoires. Mais c’est parce que la vie quotidienne est comme ça, que j’habite à Ixelles à côté d’un supermarché – ça n’élargit pas beaucoup le champ d’investigation.
Restons dans l’actualité si vous le voulez bien. Quel est le statut de l’écrivain belge de la Belgique incertaine d’aujourd’hui ? Et pensez-vous qu’il existe une communauté d’auteurs belges sans distinction de langue ou qu’il existe deux communautés d’auteurs, à l’instar de notre fonctionnement institutionnel ?
Je pense qu’il y a une communauté d’auteurs, certainement. Je trouve qu’il y a une république littéraire francophone en Belgique. Les auteurs se connaissent, se fréquentent. Ne se rencontrent pas comme ils le faisaient avant, dans des bistros, ou bien ils faisaient des salons. Maintenant ça se passe plus dans des cadres prévus pour, des librairies, Passa Porta, la Maison des auteurs, des réunions, … Mais ils se connaissent, ils se lisent. Je crois qu’il y a un climat littéraire. Je suis bien placé pour savoir qu’avec les auteurs de l’autre côté de la frontière linguistique, il y a très peu de contacts. Il y en a moins qu’il y a pu en avoir du temps où la Belgique avait une autre forme et où ces contacts se passaient essentiellement en français. Je peux parfaitement comprendre que les écrivains flamands se soient fatigués. Ce qui s’est passé dans le domaine de la littérature préfigure ce qui se passe dans le pays. Ce détachement, et ce repli surtout, des flamands, parce que c’est un vrai repli dans la mesure où ils ne se sentent pas tellement proches des auteurs des Pays-Bas, à la grande différence de nous par rapport à la France. Ils sont assez isolés en fin de compte. Il y a un mal-être foncier. Certains disent que je suis le dernier pont entre les deux littératures du , sous prétexte que j’ai été longtemps professeur de littérature flamande, que j’ai traduit des auteurs flamands, que j’ai des relations agréables avec certains d’entre eux comme Geert Van Istendael ou Stefan Hertmans mais c’est plus conjoncturel. Quand on cherche à en créer ça ne dure pas. Ce qui me fait de la peine là-dedans, c’est le sens de l’historie parce que j’ai l’impression que c’est comme ça, irréversible, qu’un des premiers signes du démembrement de la Belgique est justement la désolidarisation de ses auteurs. Et que ce pays souffre de n’avoir pas compris à quel point ce signal n’était pas dérisoire.
Il s’est produit des choses étonnantes. Au moment de la sortie du Chagrin des Belges, où par la réussite de la traduction, par le fait qu’il y avait une bonne répercussion et une curiosité de longue date de la part des francophones à l’égard de Claus, en particulier. Du fait qu’il n’était pas du tout un fanatique communautaire et linguistique. Il disait qu’il était un flamingant fransquillon. Il y a eu ce phénomène en 85 du Chagrin des Belges en français.
Et puis il y a un autre grand rendez-vous. Je crois qu’on a sous-estimé à quel point la bande dessinée a été un des derniers ciments possibles de la Belgique. Il faut se dire qu’en 45, la Belgique était aussi au bord du gouffre, au moment de la Question royale. Nous avons vécu à ce moment-là cinq ans de régence dont plus personne ne parle. Il n’y avait pas de roi, il y avait son frère obligé de remplacer Léopold. Qu’est-ce qui réunissait les Belges ? La bande dessinée. Que ce soit la francophone, avec l’équipe de Tintin et celle de Spirou, ou la flamande, à travers Suske en Wiske, les deux passaient la frontière et les enfants vivaient dans le même imaginaire. Pour des gens de notre génération, la Belgique existait à travers cet imaginaire-là. Nous avons tous des souvenirs du Fantôme de Beersel, qui est une bande dessinée typiquement flamande, du fait que Bob, Bobette et Lambique étaient des Anversois en réalité, tout ça allait de soi. Et la traduction était immédiate. Tout ça était considéré de très haut par les intellos, évidemment, pour lesquels ça n’existait même pas alors que c’était le facteur principal de la convergence possible encore des sensibilités à ce moment-là. C’est fini. Maintenant, la bande dessinée est devenue plus que le huitième art, on spécule sur les dessins originaux des artistes. Ils sont devenus ce qu’ils étaient, de véritables géants de l’art de leur temps, dans une période qui a été égarée dans les formes de la non figuration en arts plastiques. Eux qui étaient alors des hyper figuratifs occupent maintenant le haut du pavé. Ce n’est pas par hasard qu’il y a un musée Hergé ou que les Schtroumpfs nous ont représentés à la dernière Exposition universelle. Ça va de soi mais on ne l’objective pas assez. Cet instrument-là a beaucoup perdu du moins dans l’enfance parce que les enfants ont d’autres choses à regarder, à lire, et ce n’est pas Harry Potter qui va réunir les petits Belges.
Y a-t-il encore (a-t-elle jamais existé ?) une littérature belge maintenant que la notion de belgitude est tombée en désuétude ou, du moins, semble agir comme un répulsif au sein du champ littéraire ?
À ce point-là ? Je ne me suis pas rendu compte que la belgitude était un répulsif. Je conçois que la belgitude se soit un peu rangée parmi les choses du passé. Elle est datée.
Chacun a un rapport particulier à la belgitude. Il y en a pour qui ça n’existe même plus du tout. Il y en a qui sont assez jeunes pour ne plus sentir du tout le sens que ça peut avoir. Pierre Mertens a mis la belgitude sur les rails, puisque c’est lui qui avait animé le numéro des Nouvelles littéraires et puis, comme c’est un peu dans son tempérament, il l’a brûlée sur l’autel de son propre parcours très peu de temps après, avec son texte Pour en finir avec la belgitude. Je pense aussi que les raison pour lesquelles on se positionne d’une façon ou d’une autre par rapport à ça diffèrent d’un individu à l’autre. Je crois que Jacques Sojcher reste proche de la belgitude. C’est lui qui est à la base de La Belgique malgré tout. Alain Berenboom reste un belgitudinien. C’est un peu lié au fait que ce sont d’une certaine façon des immigrés à leur manière. C’est ce que je montre dans Parades amoureuses où j’annonce déjà que le bourgmestre de Bruxelles sera un jour musulman. Dans le texte, sa fille récite en flamand un poème d’Hugo Claus. C’est quelque chose qui n’est pas du tout stupéfiant aujourd’hui, c’était plus étrange de l’écrire il y a vingt ans.
Donc pour toutes ces raisons-là, ça embarrasse beaucoup le propos et ça explique en partie l’attitude xénophobe de certains partis nationalistes. Les nouveaux venus ne sont pas récupérables par le nationalisme sous-régional. C’est-à-dire qu’ils viennent ici et ils sont Belges, même si ils ne se comportent pas comme les Belges auraient souhaité qu’ils se comportent. Mais ils sont Belges. Donc ils entretiennent la belgitude. Tout ça est très complexe. Je suis prêt à admettre que la Belgique que nous avons connue est révolue. De là à dire qu’elle est condamnée… Elle ne sera pas plus rapidement abolie que d’autres pays faisant partie de l’ensemble européen. Je crois qu’il vaudrait mieux essayer d’éviter de continuer à faire du sur-place parce que ça commence à nous coûter très cher au niveau économique.
Pensez-vous que le chemin des maisons d’éditions françaises s’apparente toujours à un chemin de croix pour nos auteurs septentrionaux ?
Je ne crois pas que les éditeurs français soient les responsables de grands problèmes. Un éditeur français ne voit pas très bien ce qu’un auteur belge a de particulier. Ce n’est pas là que ça se joue. Mais le système éditorial français, avec la distribution, la diffusion et l’information, est révoltant par rapport au droit que l’on devrait avoir en Belgique francophone d’y compter quelques éditeurs littéraires dignes de ce nom. Tout ce qu’on a pu tenter de faire au fil du temps ne permet pas un avancement réel. Il y a un protectionnisme de l’édition française qui fait que le livre édité ici n’a pas le droit de circuler dans l’ensemble de la francophonie. Or, on sait aujourd’hui qu’on n’amortit pas un livre sur 4 millions de francophones belges. C’est épouvantable. J’ai un élément tout à fait concret à apporter, qui s’est passé il y a longtemps. C’était à l’époque où Jean Muno avait sorti un très beau livre, L’histoire exécrable d’un héros brabançon. J’ai rencontré à ce moment-là Bernard Pivot. Je lui ai dit que s’il devait inviter une seule fois un auteur belge édité en Belgique dans son émission, ça devrait être celui-là. Il m’a répondu qu’il faisait 48 émissions par an, 6 invités en moyenne par émission ce qui en fait environ 300, sélectionnés parmi une production qu’il estimait à ce moment-là à peu près de 6000 livres « susceptibles de ». Il n’employait pas encore le mot, mais son émission était vraiment la plus prescriptive qui soit. Il m’a dit qu’il me croyait parfaitement et qu’il lirait le livre, mais qu’il ne pourrait pas faire ce que je lui demandais, sauf si je pouvais lui garantir qu’au lendemain de la diffusion de l’émission le livre serait dans toutes les librairies de France. Si je ne pouvais pas lui donner cette assurance, il aurait tout le milieu éditorial contre lui. Pourquoi aurait-il réservé un siège à un livre qui de toute façon n’était pas dans le circuit ? Il aurait pu faire une sorte de galop héroïque mais ça n’aurait rien changé de fondamental. Sa réponse était pragmatique et exacte. Pour qu’un livre soit concurrentiel par rapport aux livres édités à Paris ou dans des maisons comme Actes Sud, il faut que ce livre ait la même présence commerciale potentielle. Dans l’édition belge, on l’a réalisé pendant des années dans la bande dessinée et certains autres secteurs. On n’y arrivera que très difficilement dans le domaine littéraire pur. Pendant longtemps, j’ai plaidé, et même auprès d’éditeurs en France, pour qu’ils ouvrent des officines éditoriales à Bruxelles. Quand je dis que l’auteur belge est perçu à Paris sans réserve particulière, ce n’est pas tout à fait exact dans certains cas. Je l’ai vécu personnellement. Lorsque j’ai écrit Le ventre de la baleine, je l’ai présenté chez Grasset parce qu’ils avaient publié mes deux livres précédents. Mais c’est un livre qui fictionnalise une affaire qui s’est passée en Belgique, qui a énormément frappé le public belge, et il me paraissait très utile que ce livre sorte très vite. Je leur ai présenté le livre en mars et ils m’ont dit qu’il était impossible de le sortir à ce moment-là. Dans ces conditions, je l’ai retiré et le livre a été pris par Labor. Il est sorti le jour où Alain Vanderbiest a été incarcéré pour la première fois. On m’a invité au JT et on en a vendu 2000 dans la semaine, le tirage était épuisé.
Là, ce qui manque, c’est ce que j’appelle l’éditeur de proximité, au sens précis d’éditeur et non de publisher. Il faut quelqu’un qui « sent », c’est ce dont la France manque. Il y a une solution, que je tente maintenant avec les Modèles réduits dans la nouvelle maison d’édition La Muette qui est associée avec une maison à Bordeaux, Le bord de l’eau. Ce qui permet aux livres de La Muette d’entrer dans le circuit de distribution en France. C’est une association entre deux petites maisons qui échangent leurs apports.
L’édition est une industrie et il la penser comme telle. On ne fait pas de livres simplement avec des subventions d’Etat. Il faudrait une étude sérieuse et réfléchie sur ce fonctionnement-là, les rendements, les risques, la promotion, l’articulation de la production sur la diffusion. Il faut une mise de fonds conséquente au début, évidemment, récupérable petit à petit. Dans un contexte économique qui n’est pas très favorable, où il faut faire preuve de beaucoup d’imagination pour se faire remarquer. Mais j’ai renoncé à l’idée que des livres littéraires fabriqués en Belgique sans possibilité de présence structurelle sur le marché français puisse fonctionner. L’édition française est elle-même aux abois, elle est entraînée dans une fuite en avant incroyable. 700 livres pour la rentrée littéraire, c’est suicidaire !
La révolution numérique est dans tous les esprits des acteurs culturels. Pensez-vous qu’elle modifiera le centre de gravité du monde de l’édition en francophonie – et, plus largement, dans le monde ?
Elle est en train de le faire dans le monde, de toute façon. Il ne faut même plus l’envisager – elle est là. Et elle va croître et embellir, inévitablement. Nous sommes des privilégiés qui vivons dans une ville équipée de librairies, où on peut flâner, feuilleter… Il doit y en avoir 25 dans la partie francophone du pays qui sont des réserves culturelles. Pour le reste, les gens qui s’intéressent à ça sont amenés à se procurer des livres par Amazon, etc. Donc ça signifie qu’ils font leur choix sur écran, sur base d’une information partielle. Ils sont prêts à l’admettre. L’avantage, c’est qu’on leur apporte le livre à domicile dans des délais extrêmement rapides. Le prix du livre est le même qu’en librairie sauf que les opérations d’approvisionnement, de transports, et trois ou quatre professions sont passées aux oubliettes. Mais on maintient le même prix. Ce sont donc des structures qui s’enrichissent fortement. Entre l’identification d’un livre sur un écran qu’on a envie de se voir déposer le lendemain dans sa boîte et un livre qu’on va tout de suite trouver sur le même écran et qu’on va probablement à terme devoir payer moins cher, on peut constater que des changements prononcés sont annoncés.Actuellement, on admet encore en France que la TVA sur les livres numériques soit plus élevée que sur le livre « courant », ce qui est une aberration. Il va y avoir à un moment donné, comme pour la téléphonie mobile, une recommandation européenne allant dans le sens du nivellement des tarifs. À ce moment-là, même ceux qui disent qu’ils préfèrent avoir le livre en main, avoir la sensation tactile de tourner les pages, tout ce côté romantique va quand même perdre du terrain par rapport à l’avantage matériel.
D’autre part, j’ai ici des livres partout, jusqu’à la cave. Qui peut encore consacrer tant d’espace à des livres ? Inéluctablement, le livre traditionnel va survivre mais sous une forme très sophistiquée. Il y a une gadgetisation du livre qui peut aider à le faire survivre mais pas beaucoup plus. La bibliophilie ne périra pas.
Comment, à l’intérieur de ce système-là, maintenir des fonctions très importantes de l’édition comme nous l’entendons, en tout cas dans le domaine littéraire, avec une sélection, une confiance fondée sur le label, c’est la question.Je peux très bien imaginer un lecteur argentin amoureux de la langue française qui va sur net et y acquiert un livre par cette voie-là parce qu’il n’imaginerait jamais se le faire apporter par la mer.
Ce n’est pas une régression, c’est un progrès. Il va falloir travailler avec ça et veiller à ce qu’il n’y ait pas une priorité de la médiocrité sur la qualité- mais je crois que c’est toujours provisoire.
Quels sont vos projets ?
J’ai plusieurs choses, un peu dans le désordre. J’ai vraiment vécu quelque chose de fantastique quand j’ai travaillé à l’opéra. C’est d’ailleurs là que j’ai commencé à m’intéresser à Wagner. On apprend beaucoup en travaillant dans ce domaine-là. Actuellement, j’ai deux-trois idées d’opéras. Je pense à des musiciens que je connais. Cela dit, il faut monter la production et c’est difficile. C’est un travail collectif que j’ai aimé. C’est la chose qui me motive le plus.
Si je me mettais maintenant à un roman, il serait beaucoup plus ample que ce que j’ai fait jusqu’à présent. Je ne pourrais plus concevoir qu’on puisse écrire un roman comme une pièce de théâtre, dans une espèce de sprint. J’ai plus d’ambition, avec aussi le sentiment que la Belgique qui est peut-être en train de se défaire a droit à une évocation romanesque qui rende compte de ce qu’elle a été. Ça m’amuse beaucoup de parler de Bruxelles, parce que c’est une ville qui fait rêver des tas de gens et sur laquelle il y a très peu de matériau romanesque. Donc, il y a un vide à combler. C’est un vaste projet…