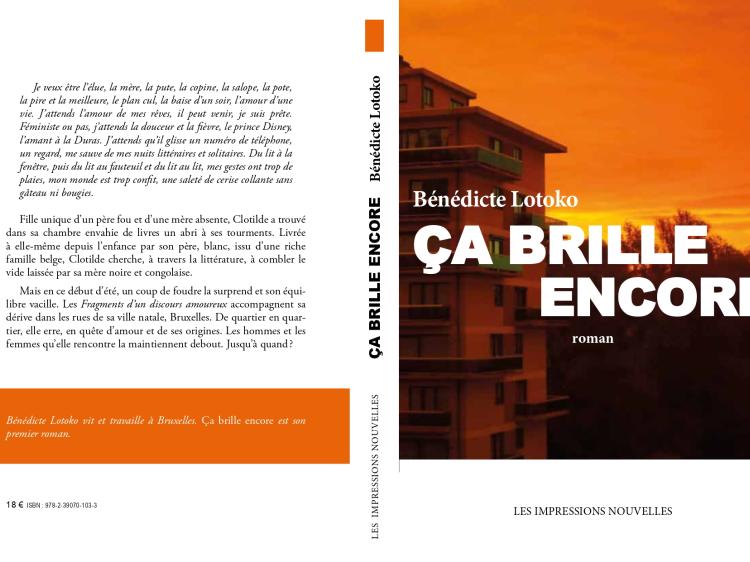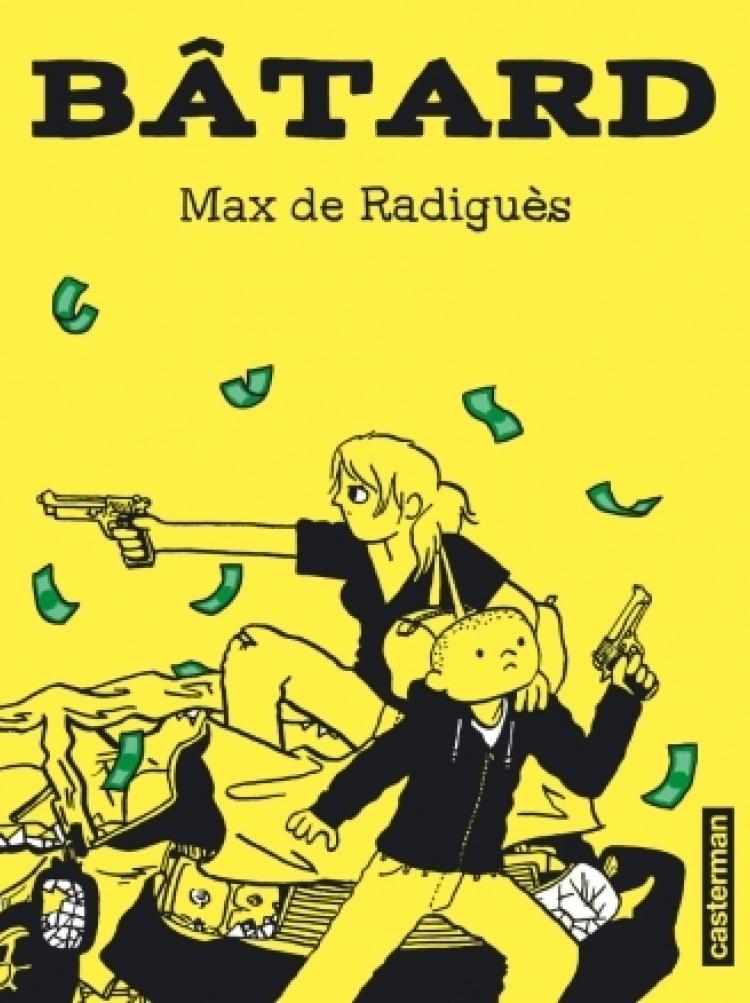Kenan Görgün, Autour d’Anatolia Rhapsody
Kenan Görgün est l’auteur de cinq romans, il est scénariste. Il est aussi un homme en prise avec son époque, en questionnement par rapport à ce qui l’entoure, par rapport à son vécu, ses origines, et tout ce qu’elles impliquent. Il publie aujourd’hui le premier tome d’une trilogie consacrée au déracinement, à l’exil et l’immigration, Anatolia Rhapsody aux éditions Vent d’ailleurs.
On ne l’attendait pas là, mais on l’y trouve tout entier. Le texte est fort, sans détours, sans concession, personnel, engagé, émouvant. Nous l’avons rencontré pour en parler.
Anatolia Rhapsody est très différent de ce qu’on connaît de toi, de Fosse commune (Fayard) à Partiot Act (First édition) en passant par l’Ogre c’est mon enfant (Luce Wilquin). J’ai le sentiment que ce livre répond à une urgence. Il y a bien sûr le 50e anniversaire de l’immigration marocaine et turque, mais il y a aussi quelque chose de plus intime, de plus profondément politique. Il y a une mise en danger. Comme si tu avais désormais la possibilité, après avoir « acquis » le statut d’auteur, de venir mettre en péril ça, en abordant désormais quelque chose qu’on attendait peut-être pas ou plus de toi. C’est assez surprenant je trouve.
Oui, il y a de la mise en danger, mais qui est volontaire. J’ai au départ de ma carrière d’auteur consciemment verrouillé certaines portes. Déjà très tôt quand j’ai senti que l’écriture ça allait être quelque chose d’important dans ma vie, et quand j’ai compris qu’avec un peu de chance je deviendrais écrivain, j’ai fermé les portes que j’avais le plus voulu ouvrir, paradoxalement.
J’avais trop peur de ce qui pourrait sortir. Et peur de ne pas être prêt.
Peur de ce qu’on attendait de toi aussi ? Et cette pression-là ?
Oui évidemment, et il y a toujours cet esprit de contradiction chez moi qui consiste à ne pas faire ce qu’on aurait pu attendre de moi. Ça m’a joué des tours mais ça m’a permis aussi de voir l’envers du décor. J’en parle dans Anatolia Rhapsody, des quelques journalistes qui m’avaient contacté à l’époque de l’Ogre c’est mon enfant (NDLR : le premier roman publié de Kenan Görgün), surtout pour l’« exotisme » ; ils voulaient voir l’auteur d’origine turque, et on leur disait « mais le livre alors ? », et ils répondaient « oui on va le lire, on va le lire ».
Et puis il y avait la pression de la communauté, de la famille, qui me disait « raconte-nous, raconte ce que nous sommes, raconte ce qu’on a vécu ». Ils attendaient que je parle de ce vécu qui était le mien en partie, mais auquel j’étais étranger aussi par ailleurs, puisque je suis né en Belgique. Moi ce que j’ai c’est la mémoire émotionnelle de tout ça, l’expérience directe, mémoire émotionnelle qui est fondamentale bien sûr, mais il fallait trouver les mots.
Fallait-il que tu passes par une phase de rejet, pour pouvoir parler de ça aujourd’hui, avec toutes les armes que tu as développées au fur et à mesure des années ? Comme si tu étais en quête de légitimité depuis des années, non seulement dans ton statut d’auteur mais aussi et plus fortement encore dans ta condition de fils d’immigré ?
Oui et c’est un combat difficile à mener. Une double quête pour un double exil.
Je me suis demandé ce que je devais/pouvais faire de cette écriture, de ce désir d’écrire. Comment, si c’est possible, arriver à devenir un auteur, à publier mon travail ? Et comment arriver simultanément à effacer dans le regard des gens, des lecteurs, mon « origine ». Comment y arriver en échappant aux étiquettes ? En étant là où on ne m’attend pas, d’abord. Puis, avec des fortunes diverses, les livres ont commencé à exister et, quelque part, le seul fait qu’ils existent, qu’ils soient écrits en français, que certains saluent même la langue, le travail de la langue dans mon écriture, plus que l’accueil qu’on réserve à ces livres par ailleurs, a été une première façon de me rendre légitime, auprès d’un lectorat « anonyme », pas forcément marqué par une identité, et de faire accepter une fois pour toutes aux miens que j’étais écrivain de langue française.
Je n’étais donc peut-être pas l’écrivain qu’on aurait voulu que je sois.
Mais dans l’autre sens aussi maintenant, parce qu’à l’inverse, je n’attendais pas un tel livre de toi. Quand je t’ai découvert en tant qu’auteur (de l’Ogre, Fosse commune, Patriot Act), je n’ai absolument pas pensé, à travers tes livres, au bagage d’ « exil » que tu véhiculais… donc tout à coup je lis ce livre et je découvre ce qui ne m’était pas apparu et qui fait sens.
Oui, je le cachais bien soigneusement. Je me rends compte que le fait de faire ce bouquin maintenant met en lumière tout l’occulté des livres précédents. Je crois que je me suis tellement obstiné à le cacher qu’on dirait que j’y suis arrivé. Pourtant, mon statut de fils d’immigré turc, on me l’a rappelé à chaque livre qui sortait, et il s’en trouvait toujours quelques-uns pour me demander où j’étais dans le livre… je savais que c’était une question importante, je savais pertinemment que c’était essentiel, mais ce n’était pas le moment.
Je vais continuer à écrire de la fiction bien sûr. Elle reste mon langage principal. Anatolia Rhapsody est à mi-chemin entre le récit et l’essai. Il tourne un peu autour du cinquantième anniversaire de l’immigration, mais c’est aussi un prétexte pour parler d’autre chose, de mon expérience de l’exil. C’est comme une sorte de chantier que je viens d’initier dans mon parcours d’écrivain. Certains m’ont dit que c’était étrange pour un auteur si jeune d’écrire un livre somme, mais je ne l’ai pas écrit comme un livre somme mais plutôt comme un livre chantier, un livre laboratoire dans lequel je vais laisser germer des choses qui vont nourrir mon écriture probablement pendant plusieurs années, mon écriture de fiction.
Ça inaugure une sorte de veine autobiographique ? J’ai l’impression qu’on est dans un essai oui mais qui se rapproche aussi de ce que tu fais en poésie, c’est-à-dire en prise directe avec l’intime, et du coup plus politique, puisque ça suppose un engagement.
C’est immédiatement plus politique dès lors qu’il y a un engagement plus personnel. Quelque part, le refus pendant plusieurs livres de parler de ces choses-là c’était le refus d’un engagement de ma part. Je me tenais à distance. La fiction était comme un filtre, un barrage.
Aujourd’hui tu n’as pas peur qu’on te reproche ce livre-ci ?
Je ne sais pas s’il s’en trouvera pour me le reprocher, mais ça ne me fait pas peur. J’ai publié cinq livres de fiction dans lesquels je me suis arrangé pour disparaître totalement derrière mes textes, mes personnages. J’ai essayé de créer à partir de rien des univers, alors qu’on est censé créer à partir de soi aussi. J’ai joué un peu à cache-cache avec les gens qui me lisent mais aussi avec moi-même. Et j’ai senti à un moment donné, après le cinquième livre, Patriot Act (qui remonte à 2009 l’air de rien), j’ai senti qu’il fallait que j’arrête de publier, volontairement.
Mais pas d’écrire ?
Non pas d’écrire, au contraire. Je n’ai jamais autant écrit depuis que j’ai arrêté de publier, et je pense que c’est une des meilleures décisions que j’ai prise de toute ma vie. Ça m’a mis en danger. Après avoir publié un livre, deux livres, trois livres, on commence à s’inscrire dans un certain rythme, on commence à créer un certain entourage dans le milieu de l’édition, etc. Mais à ce moment-là est survenue une crise personnelle de remise en question qui m’a fait prendre le risque de dire : j’arrête, j’arrête tout.
Ce n’était pas parce que tu étais plus pris par le cinéma ?
Pas du tout. Entre temps, c’est vrai, j’ai pris le temps de vivre, de me marier, de faire un film, d’écrire un film pour quelqu’un d’autre, j’ai pris le temps de faire des choses qui ne se voient pas forcément, parce qu’elles font partie de ma vie personnelle. Tout ça a été provoqué par la décision de me mettre à l’écart du monde de l’édition, en sachant plus ou moins que c’était dangereux, mais que c’était nécessaire. Du coup j’ai continué à écrire mais en refusant de publier, j’ai coupé les ponts un peu, et ça a fait énormément de bien à mon écriture. Il a fallu pendant ces trois-quatre ans que je me demande pourquoi finalement j’écrivais, et ce que je voulais en tirer, à quoi ça devait servir si ça devait servir à quelque chose.
Je voulais d’un part régénérer mes thèmes et surtout me confronter à cette porte verrouillée et me demander : qu’est-ce que j’ai à offrir aux gens ?
Et à qui tu t’adresses ? J’ai envie de te demander à qui est destiné Anatolia Rhapsody ?
J’espère que les Turcs le liront, mais il peut s’adresser à tout le monde. J’espère que les gens qui avaient l’habitude de me lire le liront aussi, parce que c’est éclairant pour ce qui a été fait jusqu’à présent et pour ce qui va être fait dans la suite, dans l’écriture de fiction notamment.
Mais il y aussi un éclairage qui est fait sur la thématique qui est très intéressant, sur la situation de cette deuxième ou troisième génération de l’exil… j’ai l’impression que tu vas vers la sociologie, que tu vas dénouer le cliché, là où on ne l’attend pas forcément. Ton rapport à l’exil est très intéressant et très différent de ce qu’on voit habituellement, il me semble. Tu parles de toi en tant que marginal et de la Belgique et de la communauté turque de Belgique, mais aussi des Turcs de Turquie. Tu es dans un double voire un triple exil.
Oui je suis quelque part en train de cultiver ce déracinement. J’ai découvert que la quête des racines était une quête vouée à l’échec. La solution est d’en parler sans doute. Et de trouver les mots justes. A un moment donné, les gens qui sont mélangés entre plusieurs cultures, plusieurs langages, plusieurs familles émotionnelles, des familles choisies, des familles imposées, des géographies multiples, je me rends compte que tout ça n’offre pas la réponse à cette quête des racines. Et donc il faut revenir à soi et essayer de démêler tout ce qui te fait mais c’est un jeu dangereux, parce qu’on peut découvrir beaucoup trop.
J’espère que le livre arrive à dépasser la question turque, pour devenir un livre sur l’exil dans toutes ses formes. L’exil volontaire, économique. L’exil est toujours économique. C’est pour moi un des fils rouges du texte et de ceux qui vont lui faire suite. Soit il est économique par choix parce que tu vas gagner plus en allant travailler ailleurs, soit tu es victime du choix économique d’un autre.
Là on en arrive à 50 ans d’immigration. On fait un bilan. Et si on est honnête il n’est pas totalement positif. Le discours dominant va probablement être positif, et il y en a des choses positives, mais pas que. Il va y avoir des célébrations. Les gens vont continuer à essayer de faire ce qu’ils ont fait jusqu’à maintenant, c’est-à-dire vendre des produits prêts à la consommation.
Mais moi ça ne m’intéresse pas de servir la soupe ni à ma propre communauté ni à la Belgique. Ça va être un peu un baromètre pour moi. J’attends la réaction des gens et des Turcs notamment.
Quel impact espères-tu que ce livre pourrait avoir ?
J’espère que ce livre fera un peu de vagues. J’espère aussi que les Turcs se verront plus clairement. J’espère que les Belges verront plus clair. Qu’ils verront plus clair en eux et qu’ils verront plus clairement la communauté d’en face. J’essaie de donner des exemples d’autres Belges qui vivent ailleurs et qui reproduisent des schémas, les « expats » par exemple. C’est universel. Il faut revenir aux vérités premières avant de juger les gens et se demander si quelque part tout ça n’est pas très normal. Et en même temps c’est une fatalité, les Turcs ne repartiront plus, ils sont là. Ils ne sont plus les Turcs de Turquie. La plupart des Turcs de Belgique qui vont là-bas se sentent complètement dépaysés et sont contents de rentrer en Belgique. Il y a là quelque part une équation qu’il va falloir résoudre à un moment. Ça prendra peut-être encore 40 ans. Je n’ai pas fini d’en parler. Et maintenant que j’ai ouvert la porte je ne vais pas m’arrêter. Que ce soit par la fiction ou par des textes comme celui-ci à mi-chemin entre le récit et l’essai.
Tu parles dans Anatolia d’ « écrivain mutant »… qu’entends tu par là ?
J’avais écrit il y a quelques années un article qui s’intitulait « Bienvenue dans l’âge mutant ». J’y parlais bien évidemment des Turcs, du vécu entre deux langues, mais je m’axais sur quelque chose de vraiment plus générationel. Je suis convaincu que quelle que soit la nationnalité, belge, italien, espagnol, arabe et turcs, les jeunes partagent quelque chose qui les distingue fondamentalement des générations passées et c’est ce qui en fait une génération de « mutants ». C’est une notion que je ne maîtrise pas totalement dans ce que j’essaie de lui faire dire mais qui est là, dont j’ai l’intuition, et qui va se préciser et qui va m’accompagner encore quelques temps. Je ne suis pas écrivain belge, je ne suis pas écrivain turc, je suis écrivain mutant. J’ai essayé d’être un écrivain belge, je ne suis pas sûr d’y être arrivé. J’ai essayé d’être un écrivain turc, mais j’ai vu que non, que je ne l’étais pas, que je ne pouvais pas l’être. Je constate que je ne le suis pas. Donc je ne peux être que mutant, et je ne peux être mutant dans tout ce que je fais. Et je pense que c’est quelque part là qu’on peut se retrouver, jeunes et issus de l’exil.
Anatolia est le premier volume d’une trilogie qui va être éditée chez le même éditeur, Vent d’ailleurs ?
Oui. C’est une trilogie qui commence avec Anatolia Rhapsody, puis il y a Rebellion park, et le troisième dont le titre est Democrazy blues.
Et J’habite un pays fantôme ? Il fait partie de ce cycle ?
Alors celui-là il va paraître chez Couleur livres. C’est un texte très différent. C’est une méditation, complètement intérieure. Il n’y a plus une dimension historique, sociologique, c’est vraiment un texte qui part de l’intime pour parler du déracinement, et la vacuité du déracinement dans le monde d’aujourd’hui. C’est une vision totalement intériorisée, dans l’émotionnel et dans le ressenti. L’écriture est plus de l’ordre de la prose poétique, d’une longue prose poétique, sans ancrage historique ni géographique. Donc il vient en complément à Anatolia Rhapsody.
Rebellion park lui, va faire suite à Anatolia et va creuser la dimension économique et politique de l’exil et les retours de flamme de cet exil. Je termine Anatolia par mon départ vers Istanbul. Je commence Rebellion park par mon arrivée à Istanbul.
Tout ça va être publié à quel rythme ?
Ça va se faire de manière assez rapprochée. Anatolia Rhapsody sort maintenant, à l’occasion de la Foire du livre. Rebellion park, je voudrais qu’il existe à la rentrée. J’attends un évenement décisif pour écrire le dernier chapitre de ce livre : les élections municipales turques qui ont lieu fin mars qui vont être décisives, et puis il y a les élections présidentielles fin août.