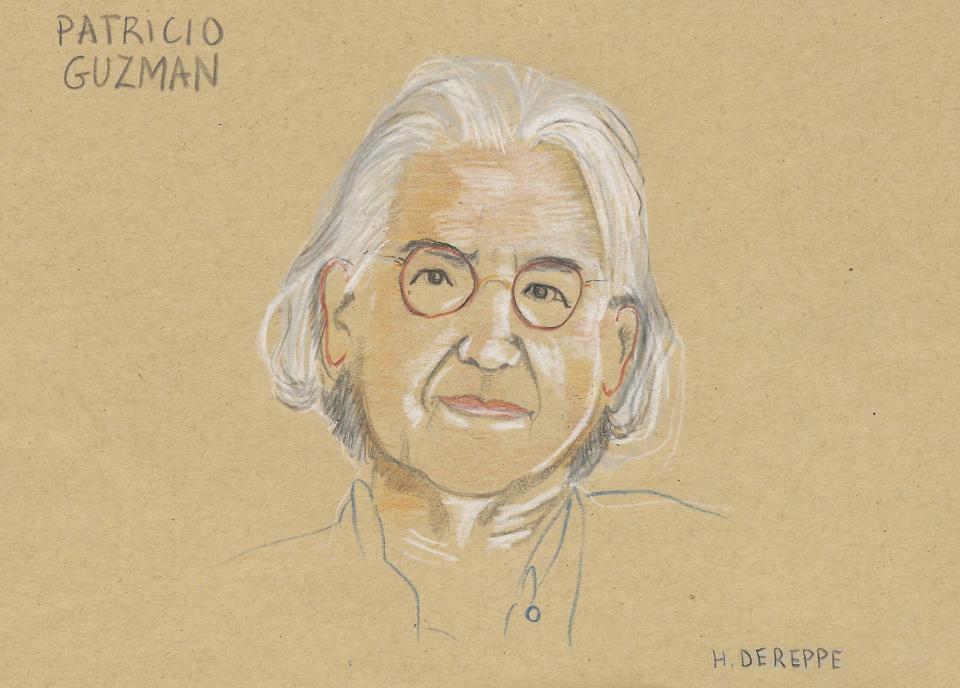De retour du FID, le Festival international de cinéma de Marseille
En 2016 à nouveau, la Scam a soutenu le séjour de plusieurs étudiants belges qui se sont rendus à la 27ème édition du FID, le festival international de cinéma de Marseille. Proposant un programme de 130 films à près de 23 000 spectateurs, ce festival s’impose aujourd’hui comme un gisement de nouvelles cinématographies, productions documentaires aussi bien que fictions. Vous n’y étiez pas ? Les étudiants vous en ont ramené des billets, écrits ou dessinés, à découvrir ici.

LE FID, QUEL GENRE DE FESTIVAL ?
par Hélène Dereppe
Contrairement à ce que son intitulé laisse entendre, le FID n’est pas uniquement un festival du film documentaire. Non seulement peut on y voir des fictions mais également des hybrides de genres et autres films expérimentaux, pour la plupart inédits. Grâce à sa reconnaissance mondiale, le FID est devenu une plaque tournante du cinéma alternatif, où se rencontrent chaque année cinéastes et curieux du monde entier, reflétant ainsi l’étendue de sa palette de diversités.
Cette année, le mistral a soufflé impétueusement sur le FID alors que les événements de Nice secouaient les festivaliers et la France entière. Et si le vent semblait répondre à la tristesse générale, accablante, les films eux, semblaient tisser des liens entre eux laissant pointer à l’horizon un espoir. Comment vivre avec les autres dans leurs différences ? Après tout, nous sommes tous faits de la même chair et des même os. C’est le terrain qu’explore Tamar Hirschfeld, une étudiante du Fresnoy, dans son court-métrage Sheldon, le squelette humaniste.
Loin d’être réduit à un simple festival du documentaire, le FID propose des réflexions, comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde.
Hélène Dereppe a aussi réalisé les illustrations de cet article.

UN FILM COUP DE CŒUR, MACHINE GUN OR TYPEWRITER ?, DE TRAVIS WILKERSON
par Anna Marcaillou
Essai fictif aux airs d’autoportrait documentaire. À Los Angeles, un homme engagé, incarné par le réalisateur du film, qui ne veut pas rejoindre de parti politique, trouve dans la création d’une radio pirate un moyen de communication militante, avant de l’utiliser pour tenter de retrouver son amour perdu.
Il s’y interroge sur la guerre, les colonies, Wall Street, la lutte des classes, et sur les raisons qui poussent les hommes à choisir la guerre plutôt que la parole. Il se questionne à voix haute : « Machine gun or typewriter ? » et reçoit alors un mail anonyme lui répondant : « Machine gun, of course. » L’animateur, intrigué, répond à l’inconnu “I’ve no idea how you found who I was. Of course I reply “who are you » and before receiving an answer I write again : »Meet me. » »
Il tombe instantanément amoureux de la femme qu’il rencontre.
Le chroniqueur nous raconte l’évolution de leur histoire d’amour en même temps qu’il se remémore les luttes et répressions qu’a vécues la ville. Il raconte comment leur amour se ternit au fur et à mesure que leurs rôles s’inversent. Elle, finalement bien plus engagée que lui, rejoint le mouvement Occupy (visant à occuper des places financières en protestation au capitalisme). Lui, occupé à partager sa vision poétique et pessimiste du monde, s’y refuse par lâcheté.
Le film est fort dans son tissage d’histoires et d’Histoire, aiguillé par la voix de crooner du narrateur. Son rythme lent, la qualité du monologue au ton décalé et cynique, et la musique hypnotisante forment une bande sonore entraînante sur laquelle le film repose. On pourrait d’ailleurs lui reprocher une forme davantage radiographique que cinématographique. En effet, le travail de l’image s’appuie essentiellement sur des archives ou photos, et se cantonne souvent à de l’illustration. Quelques idées fortes en surgissent néanmoins, avec notamment l’explosion en slow motion d’un bidon d’essence rempli de sang, et à la fin les ralentis sur des images dégradées d’Occupy.
Le film n’en est pas moins percutant, posant de façon poétique la question de l’engagement.
En prenant les traits d’un chroniqueur radio engagé qui se révèle être de plus en plus lâche, le réalisateur Travis Wilkerson s’adresse à nous tous, et en particulier aux spectateurs et cinéastes du FID : « Qu’est-ce que l’on dit, et puis qu’est-ce que l’on fait, réellement ? »
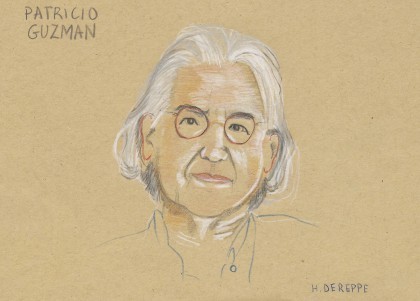
UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE ET EN DEMI TEINTE
par Mathilde Besson
Une expérience nouvelle découverte sans a priori, qui a mélangé au fil de la semaine : étonnements, déceptions, questionnements, surprises et profonds malaises ; tels des montagnes russes. Le FID ne procure aucune énergie constante. Son processus d’accumulation (films, vidéos, documentaires, fictions, expérimentations) est tellement inégal qu’il nous perd. On s’étonne de la mauvaise gestion des différentes catégories et du contexte de leur monstration. Pourquoi s’obstiner à présenter des vidéos d’artistes dans une salle de projection classique alors que leur place est indubitablement dans une salle d’exposition ? Au sein de cette programmation étouffante, la seule source d’oxygène fût l’exposition de la galerie La Compagnie.
Il semble urgent et nécessaire d’optimiser la pluridisciplinarité du festival dans des lieux et circonstances adaptés pour provoquer une énergie de qualité.

UN PORTRAIT, CLAIRE HAUTER
par Amelia Nanni
Samedi matin, 11h, terrasse d’un café marseillais.
Une petite poignée d’étudiants a le plaisir de rencontrer Claire Hauter, réalisatrice de la Nuit de la radio, qui a enchanté nos oreilles la veille, et de sa complice Sophie Gillery, documentaliste à l’INA. Elles ont concocté sur le thème de « l’adieu aux larmes » une heure trente de pépites d’archives qui met le rire à l’honneur.
Claire questionne : « Qu’est ce que les archives ont à nous dire sur aujourd’hui, comment entrent-elles en résonances avec ce que nous sommes ? » Claire, et Sophie, après une descente en scaphandrier au pays des archives, nous parlent d’une époque où Cocteau rêvait la radio comme un art à part entière, d’une radio forte, créative, qui vous saisit aux tripes, une radio façonnée à la main par des poètes, des chercheurs et non pas encore des gestionnaires, une radio qui avait le temps de se déployer, de s’essayer, de naître (et non pas en 40 heures top chrono), une radio de l’avant-guerre de l’audience, pas encore devenue un outil administré par les grands groupes de presse mais une fin en soi. Mais la résistance est toujours là, et les radios libres, France-Culture, la Scam… en sont les fers de lance, heureusement !
« J’aime partir d’un thème large qui offre une liberté absolue, ce n’est qu’après une immersion dans la matière que, peu à peu, va se dessiner mon sujet. » La collecte est colossale, le rire n’est pas forcément indexé, et on s’aperçoit vite que les archives ne sont pas impartiales : tout ce qui ne répond pas à des critères de réutilisation historique, de contenu culturel/intellectuel/artistique part aux oubliettes. Claire cherche sur les ondes les accidents : « Le déraillement, où tout d’un coup le réel s’engouffre. Le plus intéressant ce sont les accidents, on s’en fiche de la machine bien huilée ! » Elle construit cet Adieu aux larmes comme un exercice de style. Elle aime casser les rythmes, bousculer, oser la durée… Le rire est un vrai travail d’orfèvre.
Un an après Ondes de Choc, l’Adieu aux larmes apparaît comme consolateur, et même si, au lendemain de l’attentat de Nice on aurait aimé un peu plus d’engagement politique, de discours, c’est un plaisir délicieux de quitter la solitude des salles obscures du FID pour se retrouver sous les étoiles, ensemble à partager un rire collectif.
Conclusion : Vive la radio ! Et que les nuits de la radio se multiplient et nous fassent rêver… toute la nuit !
UN PORTRAIT, PATRICIO GUZMÁN
par Lou du Pontavice et Chloé Léonil
L’œuvre de Patricio Guzmán porte en elle tout le potentiel d’amour du cinéaste.
Deux éléments fondamentaux de l’Amour les caractérisent :
Le premier est la fidélité.
Une des premières phrases prononcées par Patricio Guzmán lors de la masterclass qu’il donnait au FID* a été qu’en tant que documentariste, « il faut se fixer un territoire de travail ».
En effet, presque toute son œuvre traite de ce même sujet inépuisable : l’histoire du Chili. Il le traite avec le cœur, puisqu’il fut longtemps expatrié à Madrid, puis Cuba et aujourd’hui, à Paris. Raconter l’histoire de son pays semble s’être imposé comme une nécessité.
Dans la filmographie de Patricio Guzmán, chaque film vient en nourrir un autre. Il est un chercheur : dans chaque film il approfondit sa forme, il creuse dans une recherche sans fin. C’est un sujet qui tend alors vers l’universalité.
Y-a-t-il plus belle preuve d’amour que d’être fidèle à un sujet ? C’est-à-dire être capable d’accueillir au fil du temps, l’infinité des mouvements qui caractérisent le sujet du Chili, en particulier celui de la dictature de Pinochet. Puis, à partir de ces mouvements recueillis, d’en créer un événement : un nouveau film.
Le sujet de l’histoire du Chili est le point d’ancrage de Guzmán. Ce qui le définit en tant qu’artiste. C’est ce qui nous permet aujourd’hui de considérer ses films comme une œuvre.
C’est aussi pour cette raison que Patricio Guzmán – pour chacun de ses films et en particulier les deux derniers – tisse une trame narrative extrêmement élaborée : « il faut avoir une connexion physique avec le scénario ». À force de traiter d’un sujet, des centaines de connexions adviennent et englobent, non pas seulement l’histoire du Chili mais l’histoire de l’humanité toute entière.
Et de fait, on distingue deux périodes majeures dans la mise en scène de Patricio Guzmán : de La Bataille du Chili (1974) à Salvador Allende (2004), ses films enquêtent sur la dictature de Pinochet ; il y a une volonté de démontrer, de faire entendre la voix des victimes et comme il le dit lui même, la mise en scène parait plus « sèche ».
Dans ses deux derniers films, La Nostalgie de la Lumière (2010) et Le Bouton de Nacre (2015), les liens sont plus poétiques, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Il s’intéresse à des zones géographiques précises qui définissent le Chili et où se rencontrent alors l’histoire récente de Pinochet et l’histoire de l’humanité.
Le spectateur est transporté dans le temps.
Plus ancien, La Croix du sud (1994) amorce déjà cette forme plus poétique, en traitant cette fois du christianisme, son histoire, ses évolutions et sa place dans l’Amérique Latine.
Le deuxième élément fondamental de l’amour, est l’écoute de l’autre et l’exigence de l’esprit amoureux à l’accueillir.
Lors de la rencontre avec Patricio Guzmán, organisée par la Scam pendant le FID, nous parlions du Cas Pinochet dans lequel Patricio Guzmán s’entretient avec plusieurs femmes, victimes de Pinochet. Dans le travail d’un documentaire, il faut, nous dit Guzmán, avoir une écoute absolue de celui qu’on interroge sur son histoire. Dans La Nostalgie de la Lumière, ce sont une nouvelle fois les paroles de femmes qui nous ébranlent. Leurs témoignages sont recueillis avec un respect immense.
L’esprit qui écoute entraine celui qui raconte dans une méditation où le temps est alors suspendu. La parole est libre et non délimitée par le temps. Nous, spectateurs sommes intimement reliés à cette parole. C’est dans le lien que s’exprime toute la force du cinéma de Patricio Guzmán.
* En écho au Prix Charles Brabant 2016 pour l’ensemble de son œuvre remis par la Scam, le FID Marseille a proposé un hommage à Patricio Guzmán, complété par une masterclass du documentariste à laquelle ont assisté les autrices de ce billet.
UN SOIR DE FESTIVAL
par Jean Baptiste Maxime
Dernier jour du festival, cours Julien, nuit, près du centre de Marseille, âmes festives du groupe s’extirpant de la longue semaine vers un dernier verre, une envolée. J’avais encore les images en tête de…-OHpéra Muet-… réalisé par Ueinzz et Alejandra Riera, projeté au Vidéodrome, ombres de personnages marginaux produisant une pièce sans voix, percevant les dérangements sous-jacents d’un territoire trop calme. Pendant notre dernière ronde, deux hommes aguerris et éméchés sont prêts à se faire mal avec une bouteille coupante.
Une fille à l’accent marseillais débarque dans la mêlée entourée de verre et de fumée, et calme les cris. Elle commence à raconter l’histoire de son grand-père, mort des suites d’un traumatisme dû à la Guerre d’Algérie. Ses yeux pleurent. Elle comprend que la violence de l’instant reproduit la même, vécue plus tôt. Puis son corps se met à crier sur les cons alentours qui allaient se blesser. Elle crie, ses yeux sortent de leurs orbites. Son corps sue. Elle ne peut plus s’arrêter. Comme si une chose était contenue, qui devait se libérer. Son tee-shirt va se déchirer. Elle crie contre elle-même, contre un paysage trop silencieux.
UN TEMPS DE RENCONTRES ET DE TRANSMISSION
par Sébastien Perée
Le pastis ondule, les glaçons clinquent, les chaises volent sur le sifflement des masses d’air, et attaquent sans discrimination tout corps solidement liquide. Nous sommes dans le Panier, un verre dans la main, une cigarette dans l’autre. Les sons jaillissent de toutes parts, déstabilisent les conversations. De quoi parlons-nous ? De cinéma, bien sûr. Que peuvent faire d’autre des étudiants en cinéma lors d’un festival de cinéma ? Je ne peux évidemment pas n’empêcher de faire quelques blagues vaseuses. Vous n’imaginez pas la jouissance lorsque le dégoût apparaît sur le visage de vos interlocuteurs… Je me surprends moi-même à ricaner malgré la gêne causée par mes dents jaunies par le tabac.
Il pleut maintenant. Décidément, mon arrivée à Marseille se fait sous le signe du déluge. Les autres sont partis, ils savent tenir leurs limites, moi pas, je ne puise en ce moment que dans l’excès. D’ailleurs, peut-être les ai-je excédés ? Apparemment pas tous, il reste Ronnie, une sorte d’indien à la masse corporelle d’un joueur de rugby. Je ne dis pas indien par racisme primaire, mais parce qu’il me rappelle ces images des livres de mon enfance, le ton imposant et le nez fièrement cassé. Ces images s’animent devant moi. Il me dit qu’il est flamand, le mythe se casse, je navigue en plein exotisme, honte à moi.
Infidèles aux salles obscures, nous nous réfugions à l’intérieur de la taverne, armés de nos pass du FID, et d’une Chouffe, rappelant fièrement nos origines communes. Je lui fait part de mes doutes face à mon arrivée dans le monde professionnel du cinéma, de mon stress, lié sans doute à mes excès. Nous discutons de pédagogie, de ses filles, sa femme, de la construction d’une vie.
Des films, j’en verrai bien sûr, peu, mais ce n’est pas la quantité qui importe. Ce qui selon moi est le plus riche dans ce genre d’endroit, ce n’est pas tellement de visionner des films, ça nous pouvons le faire dans bien d’autres lieux. Non, le plus important, ce sont les rencontres humaines. Parler de ses doutes, ses envies, avec ceux qui sont passés par ce même chemin avant nous. C’est la transmission du savoir, mais plus encore, la transmission de l’amour, parce-que sans amour il n’y a pas de rencontre, et sans rencontre il n’y a pas de cinéma.