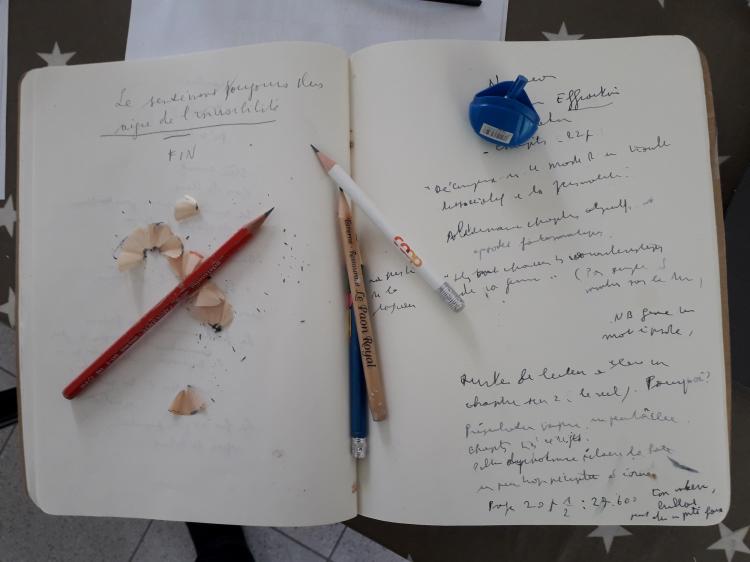L'enfance au balcon
Depuis une demi-heure, le ciel s'est couvert de vapeurs soufrées, et le vent souffle par lourdes saccades. Il n'y a pas à s'y tromper : un orage se prépare.
L'étroit balcon qui donne sur la rue est toujours plus ou moins encombré des feuilles mortes. Quand j'y pose les pieds nus, pour regarder au dehors, elles plient sous mon poids, elles crissent.
L'enfance, pour moi, c'était cela: le balcon. Un désir de fuite, une attente désespérée, et mon corps penché, cassé à la balustrade verte, les pieds nus qui piétinaient la mousse ou les feuilles, un jardin à demi en friche et plus loin, des usines, un chuintement de machines sourdes, et la nuit qui tombait en plein jour, et la liberté qui ne viendra jamais.
C'est par un après-midi comme celui-là que j'ai décidé, à 14 ou 15 ans, que j'étais un prisonnier sur parole et que pour m'en sortir, j'allais devoir truquer ma parole, mentir aux autres pour qu'ils ne soupçonnent pas que je ne songeais qu'à la fuite, et que j'étais en train de préparer mon évasion.
De mon balcon de nuages, j'apercevais, de haut en bas, le tracé d'un avenir possible, un chemin de ronces donnant sur le large. Confusément, je distinguais quelque chose dans la grisaille, quelque chose du moi perdu, que je serais un jour. J'entrevoyais avec une vitesse folle mes cadavres successifs, jetées en vrac comme les cartes d'un jeu de bataille.
J'ai réussi, à la fin, à m'évader. Ce fut même, il me semble, une évasion parfaite. Plus jamais depuis je ne me suis fais piéger. Pas même par le mensonge, mon seul vertige véritable. Je l'ai troqué pour une autre tentation, un autre vice: la vérité.
Je referme la double fenêtre. L'orage retient encore ses lignes pointillées. Plus pour longtemps.
Je suis là, bien éveillé, regardant, à travers la vitre, le monde vert qui remue, dans l'été vernis et craquant.
Autour c'est un monde de formes fermées : aquarium, baie vitrée, écrans d'images ou de textes, boule de cristal. Partout les mêmes artifices : la transparence, le décalage, le programme.
Dans la nudité du soir, avec le soleil couchant qui appuie des deux mains sur le vide, surplombant le grand hêtre sec et l'ancien séchoir à tabac, je referme les fenêtres qui balayaient au passage mes profils perdus, et je regarde passer comme une comète l'image d'un médium aux yeux rouges, en qui je reconnais, sans plaisir excessif, mon portrait présent.
L'après-midi agite ses taches de soleil et son flot de voitures. Pour un instant encore, je ne bouge pas.