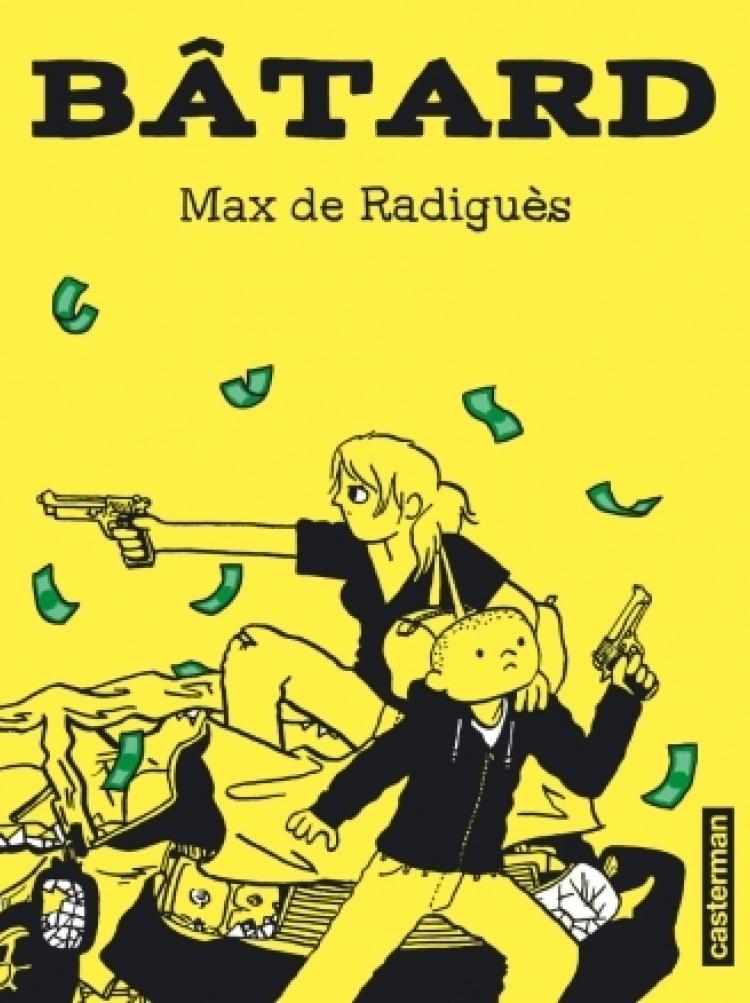« Rodéo »
par Anita Van Belle
Aïko Solovkine a surgi dans le paysage comme un geyser. Personne n’attendait cet auteur-là, cette prose sèche, ces émotions tenues à distance sous une croûte à ne pas gratter. On la lit et, admettant que la langue française ne pourrait pas être traduite avec cette justesse de rythme, on la verrait est-allemande, africaine du sud, américaine dans un département des lettres où sous couvert de conversations policées couve un immense intérêt pour les fêlures des hommes et les postures des femmes.
La prose de Rodéo est une question d’équilibre. Comment amener le visage du lecteur à quelques centimètres seulement du bouillonnement de la violence sans lui concéder jamais le déboulement de la digue rompue ? Car rien n’y fera, jusqu’au bout, au travers de chaque situation, du moindre dialogue, l’exacte distance entre le feu, la rage, les poisons, et la glace qui nous empêche d’y goûter, de nous y plonger, est maintenue. Jusqu’au bout, nous regarderons. Fascinés ? Par quoi, demande l’autrice en fausse ingénue. Pourquoi le lecteur reste-t-il ? (Ce qui ne manque pas de culot et indique en même temps la maîtrise du jeu de l’écriture, de l’exact dosage de ce que l’on nous donne pour que nous restions, nauséeux parfois, mais toujours rattrapés par les mots et leur danse, fascinante.)
Aïko Solovkine semble conserver des tiroirs pleins de manuscrits, nouvelles en enfilades, romans jamais sortis de chez eux. Elle y puise des extraits pour son écriture d’aujourd’hui, ce qui nous laisse à penser que, derrière le Prix de la première œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une cohorte de faits divers amplifiés et nettoyés à l’os forment un corpus dont les rejets troubleront encore nos nuits et nos jours.
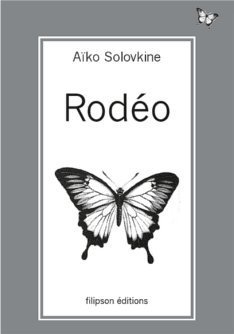
Qu’est ce qui vous a décidé à prendre un pseudonyme ?
Il ne m’est jamais venu à l’esprit de ne pas prendre de pseudonyme. Mon nom et mon prénom sont des coquilles vides qui ne me relient à rien d’aimé. Le pseudonyme, c’est la possibilité d’une seconde peau, de prendre de la distance.
Il y a du Japon dans Aïko et du russe dans Solovkine, c’est revendiqué ?
Le russe et le japonais sont deux langues dont j’aime la consonance et qui produisent une littérature que j’apprécie beaucoup. Aïko signifie « l’enfant des cendres » et Solovkine vient de l’archipel des îles Solovki « où se trouvaient les premiers goulags ». J’aime les langues où les noms ont une signification – j’ai choisi des noms très chargés, par superstition peut-être, pour conjurer quelque chose de douloureux – sans lien avec le plaisir d’écrire, juste pour brouiller les pistes. Se faire renaître avec une identité de plaisir, pour une fois qu’on peut le faire.
Comment êtes-vous venue à l’écriture ?
Je ne me rappelle plus quand je suis venue à l’écriture. C’était très rapidement. Enfant, j’écrivais mes propres histoires, je voulais être auteur. Et puis, par la lecture, cette voie banale. Chez moi, on était obligé de lire, de faire des résumés critiques de ce qu’on lisait et de les soumettre à nos parents. (Mes parents avaient une vision à l’ancienne, celle de ne pas lire « bêtement ».) On choisissait nos livres, mais il ne fallait pas les ingérer à la chaîne, c’était lié à la formation de notre esprit critique.
Quand avez-vous commencé à écrire Rodéo ? Où ?
En janvier 2014. C’était chez moi à la suite d’un pari de nouvel an, de matin de nouvel an. « Qu’est-ce que tu ferais comme film si tu devais en faire un ? » J’ai écrit le mien, Rodéo, en 3 mois et 3 jours alors que d’habitude, ça me prend des années. J’ai dû me faire violence.
Il y a eu d’autres romans qui ont précédé ?
Il y avait eu une tentative d’envoyer un roman à plusieurs éditeurs. Avec celui-là, c’était le moment de le retenter.
Où vos livres prennent-ils leur source ?
Souvent en lisant l’actualité, la presse. Un fait retient mon attention par son apparente familiarité et il possède suffisamment d’étrangeté et de zones d’ombres pour que je puisse m’y insérer… Parfois, il suffit juste d’une phrase que j’entends.
J’ai aussi dans mes tiroirs des nouvelles et des romans. J’en utilise parfois des morceaux. Des idées, des personnages…
Mais ma source première, ce sont mes obsessions, j’ai des thèmes obsessionnels, souvent liés à une actualité poisseuse. Des thèmes liés au secret. Rodéo est basé sur un fait divers réel, l’auteur d’un viol qui s’encastre dans un camion de porcs.
Exercez-vous un autre métier ?
Je suis journaliste free lance.
Qui lit vos premières pages ?
Quelques amis lisent mes premières pages. Certains depuis l’adolescence. Ils ont cette foi inébranlable en moi : « On l’a toujours su », que je n’ai pas. Ils avaient plein de certitudes quant à mon avenir et m’ont beaucoup aidée. En moi, il n’y a aucun moment qui ne soit de doute. Ils rétablissent l’équilibre.
Rodéo se déroule dans une géographie précise, un paysage post-industriel où les destins s’écrasent. Vous aviez un modèle ?
J’ai notamment grandi en Flandre dans une région où certains paysages miniers peuvent rappeler le décor de Rodéo. Ces paysages m’intriguaient.
Rodéo part de la volonté de comprendre cette espèce de claque magistrale qu’ont reçue ces régions minières comme la Ruhr, certaines régions de Pologne ou le Nord de la France, et qui n’en finit pas de les frapper. C’est la fin des promesses d’espérance. J’avais envie d’essayer de comprendre ça sans pathos, à froid et de raconter l’ennui en province : pas de moyens de transport, on meuble le temps en picolant.
Ces décors provoquent des tragédies. Rodéo est un roman sur l’ennui, sur le vide. La violence surgit souvent de l’ennui, d’un ennui existentiel. C’est une occupation comme une autre. Dans mon roman, elle ne fait qu’en découler.
Est-ce que le tutoiement de Jimmy vise un effet précis ?
Le tutoiement n’était pas là dès le départ. Le personnage que je tutoie, Jimmy, est d’une certaine manière le personnage principal, même si le personnage principal est cet agrégat de corps interchangeables que je décris. Jimmy est le seul qui éprouvera de la culpabilité, qui choisira d’expier. C’est pour moi le seul personnage libre du roman, celui qui brise ce cercle vicieux de violence et d’impunité.
Le tutoiement est venu au moment où je me suis aperçue que je m’adressais à lui. Il y a peut-être aussi un « tu » vers le lecteur parfois. Le lecteur qui regarde agir cette masculinité mal digérée : pourquoi regarde-t-il ça ?
Vous dessinez un scénario avant de commencer la construction du roman ?
Il y avait une construction au départ. Je passe beaucoup de temps à construire le squelette, à assembler les os, puis il faut mettre de la peau par-dessus. Le squelette restera par moment plus apparent parce qu’il ne faut pas tout raconter.
Je relis beaucoup mes notes avant de me mettre à l’écriture. Parfois il faut oublier les notes mais la transe reste.
Pourquoi mixer une langue stylisée et un vocabulaire barbare – pourrait-on dire vulgaire ? Les deux langues ont-elles un usage défini ?
Les dialogues participent d’un travail sur la langue plus vaste – je ne sais pas s’ils sont vulgaires, je ne sais pas ce qu’est la vulgarité. Mais c’est un exercice de parler contre sa langue et de le faire de manière ressemblante. Il n’y a rien de pire que les dialogues qui ne ressemblent pas aux personnages, et ces gars-là sont exactement ce qu’ils sont. L’un des personnages suit des cours de diction : la langue détermine la classe sociale.
Y a-t-il une identification pour le lecteur dans Rodéo ?
J’ai eu beaucoup de retours : pour peu qu’on vive en province, ces gars-là on les connaît tous – et on les reconnaît. Ça parle d’une jeunesse aussi et peut-être qu’on peut s’identifier à l’ennui. Il y a bien un moment où on s’est tous ennuyés de 13 à 17 ans. Et l’humiliation aussi, le sentiment d’être mis de côté, l’entrave permanente : toujours quelque chose qui vous barre la route.
Comment travaillez-vous votre prose ?
Comme le squelette est très construit, d’un chapitre à l’autre je sais ce qui va se passer. Du coup, je suis le rythme du récit avec ses eaux dormantes, ses rapides, ses cascades. Il a sa propre nécessité et je m’aligne sur elle. Mais je sais qu’il y a aussi la fatigue qui joue parce que j’écris la nuit, durant des nuits blanches, et avec la fatigue il y a une tension qui naît, qui correspond à une vraie tension physique. (J’enchaine parfois trois, quatre nuits blanches en travaillant pendant la journée.) Je suis seule, debout, j’écris sur une armoire – littéralement pour ne pas m’endormir, avec une espèce de rage d’être debout dans l’inconfort avec mal au dos. Donc, il fallait que j’en finisse vite ! (Rires)
Comment maîtrisez-vous vos personnages ?
D’une manière générale, je sais qui va survivre, trébucher, s’éveiller, et pourquoi. Qui va passer à travers tout. Qui va être blessé. Et à partir de là, je commence à réfléchir à eux. Ils vont devoir jouer la partie avec les cartes que je leur donne. Même s’ils me les rendent parfois dans un ordre imprévu, surprenant. Ils ont chacun leurs propres nécessités et contraintes. Celui qui devait tomber tombera. Celui qui devait survivre survivra. C’est rare que cela se passe autrement : ils ont des contraintes, s’ils veulent s’en affranchir, ils doivent me donner de bons arguments ! (Rires)
Avez-vous un arbre généalogique littéraire ?
Oh, c’est un arbre généalogique avec des branches en désordre. Il y a Elfriede Jelinek pour la froideur, la précision de son regard sur le monde, malfaisant en général. Cormac McCarthy, ce rythme et puis cette poésie incroyable. La musicalité qu’il arrive à atteindre avec ces effets rythmiques… Donald Ray Pollock. Doris Lessing, avec son sens de l’observation assez impitoyable, un œil affûté, pas très tendre, avec un sens du récit… Karen Blixen aussi : ce sens du récit… Richard Ford. Joyce Carol Oates. Peter Handke. Toni Morrison, David Vann, Jim Harrison. Agota Kristof : son économie de mots me bluffe, c’est à l’os, rien de trop. Faulkner… Mishima… Annie Proulx ! C’est une LANGUE !
Dans Rodéo, les femmes sont des proies pour la meute des hommes qui les violentent, physiquement et psychologiquement. Jusqu’où partagez-vous cette sensation ?
Rodéo parle d’un travail de virilisation permanente de ces gars – mais des femmes aussi, qui sont enfermées dans un enclos de séduction permanente. Il y a une forme de féminité qui s’approche de la putasserie, dirait Virginie Despentes. Les femmes entretiennent cette féminité en offrant leur corps et en le refusant dans le même temps. Le personnage féminin qui s’efforce de contourner cet attribut masculin qu’est le pouvoir, la seule fois de sa vie où elle va sortir de cette féminité très docile, elle sera punie. Pour moi, cette féminité-là ne crée pas une force : il s’agit de stéréotypes qui ne sont pas libérateurs. Dans mon roman, les hommes comme les femmes sont enfermés dans ces stéréotypes du genre qui leur sont assignés et qui font que quand les deux se rencontrent, ça ne peut pas bien se passer. Surtout pas là où il n’y a pas d’autre façon d’être un homme que dans la violence et dans le groupe, toujours ensemble, toujours en meute.
Verra-t-on un lien entre votre premier roman et le second ?
Le second roman est basé sur un fait divers qui sert d’amorce à un récit plus grand que lui. Il y aura toujours un côté analyse d’un milieu social – qui m’est cette fois très familier.
« En réalisant un reportage sur les quinze ans de la fermeture du Magic Planet, un journaliste de quotidien régional, a qualifié cet événement d’inauguration de l’ère post-fun. » Vous pensez que nous sommes entrés dans cette ère ?
Le récit se passe à la fin des années 90. Il y avait une sorte d’hébétude, de désarroi à être jeune dans ces années-là : on marchait sur des cadavres d’illusions. En même temps, il y avait une irruption d’un fun très criard, très outrancier – et un durcissement du jeu libéral. C’était un adieu à une ère de fun bon enfant pour passer dans une ère de fun très compétitive – triste. Pour moi, c’était lié au renoncement, à la servitude, et lié à une fin de siècle en plus. Post-fun, c’est en référence à l’innocence de ce fun un peu cheap. (Je déteste le mot fun).
>>> Rodéo est paru aux éditions Filipson en 2014.